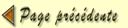 |
|
|
|
Un
recueil de quarante trois nouvelles expressionnistes |
|
L’auteur nous propose des nouvelles à la frontière
du symbolisme, de l’allégorie et de la fantaisie
onirique. Ce n’est pas un hasard si ses goûts
vont des maîtres du quattrocento à Klimt, en
passant par Arcimboldo et Gustave Moreau. Nous portons tous
un masque. Certains en sont conscients, d’autres ne
le sauront jamais. L’essentiel est de comprendre que
nous ne disposons sur Terre que de très peu de temps.
Le rêveur impénitent s’exclut de tout
pragmatisme. Notre société tente trop souvent
d’enchâsser l’individu dans la gangue
d’un modèle de pensée unique en oubliant
que nous ne sommes que de la poussière d’étoiles,
nous en venons et nous y retournons.
|
|
| |
|
EPPUR
SI MUOVE |
 |
| |
L’hiver
s’annonçait, et avec lui, le crépuscule
d’une vie, comme autant de petits flocons de neige tombant
sur la cité des Doges ; un passage obligé…
aussi riche cette vie avait-elle pu être ! Parfois,
Anna pensait que ses amis avaient raison de vouloir sentir
la vie bouillonner en eux. Qu’importe que la terre soit
ronde ou plate, au fond d’un verre, l’absence
de liquide donne toujours le même monologue : «
Tavernier, sers-moi à boire et que commence l’insouciance
! » Et c’est ce qu’il faisait, le gaillard
peu scrupuleux. Seul le bruit des ducats d’or comptait,
même si ce bruit était celui de la fin d’un
monde. Parfois, après la fermeture, et seulement si
sa demeure était sur son chemin, il raccompagnait l’un
ou l’autre pour éviter qu’il tombe dans
le Grand Canal, ou qu’il mutile les majestueux lions
qui se voulaient les derniers gardiens de l’Arsenal.
Ainsi allait la vie ! Jusqu’à cette déplorable
affaire de 1633. Honte pour l’église et mauvaise
année pour Anna Elena et son amant dont elle ignorait
toujours l’essentiel.
À l’entrée de la salle du grand conseil
de l’Inquisition, un gros condor presque aveugle sautait
dans sa cage. Dix hommes en noir entrèrent par la porte
du fond. Avec la précision du métronome, ils
s’installèrent dans le silence inquiet de l’assistance
à leur place respective.
— Que l’on fasse entrer l’accusé
! ordonna le plus âgé.
|
| |
| |
DE
LA TOUR SAINT-JACQUES À MANÁOS
|
 |
| |
C’est
dans un bordel de Manáos qu’il rencontra Sandra,
une pute française belle et soyeuse comme la peau d’un
serpent. Elle aussi était partie sur un coup de tête,
après une conversation émaillée de conseils
devenus insupportables. Elle n’avait pas trouvé
un prince charmant mais s’en était découvert
des centaines. Moins fringants que dans ses rêves.
Noyé entre le désir et la culpabilité,
Colin était devenu son colocataire de galère.
Il était fasciné par cette créature hors
de son temps qui avait fini par s’y introduire définitivement,
et cherchait dans ses yeux l’excuse de son infamante
déviation sociale. Leurs soirées s’encombraient
de discours sur l’Europe, comme si en être exclus
rendait le rêve merveilleux. Un soir, entre deux bouffées
d’une cigarette qui ne contenait pas que du tabac, elle
avait demandé : « Franchouillard, raconte-moi
ta vie ! » et Colin s’était fâché.
Sa vie s’était échappée des Illuminations
pour atterrir dans les Chants de Maldoror alors, pas de quoi
fabriquer une sonde spatiale. Il y avait d’ailleurs
bien longtemps qu’il y était, dans l’espace
! S’il avait été sincère, il aurait
dit à Sandra la douce, aux gestes subtils dans le désordre
de sa nuit, qu’il était né entre ses cuisses
et qu’il comptait bien y mourir. Sans passé,
sans présent, mais surtout sans avenir, ils descendaient
le boulevard de leurs vies crépusculaires à
la recherche d’un corps de fortune. Sandra n’était
pas difficile, il lui prêtait ce qu’il lui restait
de mieux et elle lui offrait son superflu. Mais, ses yeux
habitués à l’angoisse décelaient
ce que deviendrait le dernier morceau du triptyque de sa vie.
|
| |
 |
ANSELME
LE GRAVEUR |
 |
| |
Barthélemy
remonta son col en pensant qu’il devait perdre cette
manie qui lui donnait un côté maffieux. La vitre
lui renvoya son reflet, il n’avait pas trop vieilli
malgré cette souffrance si souvent occultée.
Dans le ciel passaient des scènes de la vie quotidienne
; il s’attarda à y mettre des noms. Là,
un ours se déformait, ici un poisson avalait l’espace
entre des nuages plus gris les uns que les autres. Il se retourna
; la haute cheminée du bateau, cerclée de rouge,
cracha par trois fois une espèce de venin âcre
qui se rependit sur le pont. On aurait dit que la mer, à
travers elle, se vengeait d’avoir si souvent été
déflorée et ensemencée de mazout. La
trace irisée de ces irresponsabilités laissait
au-dessus de la ligne de flottaison de sinistres baisers aux
couleurs de néant. Puis, ce fut la surprise. Le commandant
de bord annonça que le bâtiment était
en quarantaine, un voyageur serait porteur d’un virus
et un contrôle sanitaire devait être effectué.
Cette histoire sentait l’intox à plein nez d’autant
que sur le quai, les grévistes paraissaient de plus
en plus menaçants. Barthélemy, du pouce et de
l’index, lissa le bord de son feutre. Il s’assit
sur un banc en fer et enfonça, comme le fait la tortue,
son cou dans la carapace de son pardessus. Le temps n’avait
plus d’importance. Son grand-père disait qu’un
homme devait être capable de voyager avec toute sa vie
dans une petite valise. Barthélemy avait fait mieux,
il voyageait les poings enfoncés dans ses poches déformées
par les livres. Il avait appris la haine, siroté la
rancœur et s’était lui-même excommunié
du bonheur. On n’apprend pas l’essentiel aux enfants
! Il est des vérités que l’on se garde
bien de leur révéler. |
| |

|
FEU
L’ARMATEUR MATUVUZZIANI |
 |
|
Maria
Ivanovna marchait sans se hâter, encore sous le charme
du petit violoniste qui interprétait le matin même,
sous le porche de la cathédrale San Lorenzo, une cantate
de Stradella, prodigieux compositeur au destin tragique qui
avait été poignardé sur la Piazza Bianchi,
ici, à Gênes. Elle croisa un paysan. À
ses dires, il n’était pas tombé une goutte
de pluie depuis deux longs mois, cela expliquait le dessèchement
d’une grande partie des succulentes aux couleurs vives
qui bordaient le chemin. Elle s’épongea le front.
Il lui restait à gravir une petite sente qui ondulait
comme une vipère aspic au soleil pour arriver au palais
Matuvuzziani qui dominait le golfe.
Les grilles du parc étaient ouvertes. En le traversant,
Maria Ivanovna admira la luxuriante végétation
: cyprès, bougainvillées, citronniers sauvages
et palmiers invitaient au farniente. Une allée de galets
conduisait à un escalier monumental en marbre de Carrare
gris et rose. Il devait faire bon flâner sur la loggia
bordée de petites colonnades qui surplombait la grande
bâtisse. Elle souleva deux fois un heurtoir en bronze
au faciès de cerbère. La voix rauque qui répondit
semblait venir du fond d’un puits de pierres sèches
:
— Que voulez-vous ?
— Je suis Maria Ivanovna ! J’ai une recommandation
de maître Pietro Anselmi, le conseiller juridique du
signor Matuvuzziani, pour le poste de bibliothécaire.
— Je suis le signor Matuvuzziani !
Maria fut étonnée que le propriétaire
des lieux officie tel un maître d’hôtel
mais, avant qu’elle ait eu le temps de pousser plus
loin la réflexion, il reprit avec ironie :
— Ferait-il du zèle celui-là ? Un ancien
amant de ma femme…
La remarque de l’armateur contraria Maria :
— Monsieur, ne s’agit-il pas de mettre de l’ordre
dans votre bibliothèque ?
|
| |
 |
UN
DÉJEUNER DE MANET |
 |
| |
L’automne
était décidément bien installé.
Les graines du sycomore faisaient ployer les branches et quelques
feuilles recroquevillées par l’excès de
zèle des araignées rouges tombaient avec lenteur.
Autrefois, ces petites ailettes auraient produit des forêts.
Mais aujourd’hui… Mathurin se retourna car un
souffle tiède et humide avait effleuré sa nuque.
En souriant, l’animal se présenta :
— Je suis une licorne. Enfin, j’en ai l’apparence
! Ce monde n’aime que les légendes alors, vois-tu,
j’essaie de m’intégrer.
— Je ne suis pas aveugle, répondit Mathurin,
j’avais bien vu que tu n'étais pas une vraie
licorne !
Leur conversation avait réveillé le boa qui
ronflait, enroulé dans un lilas.
— C’est non ! dit Mathurin anticipant ses intentions.
J’ai mis des années pour que tu deviennes végétarien…
Laisse-la tranquille !
— C’est malheureux, pleurnicha le reptile pris
au piège de l’affection, autrefois elle m’aurait
fait vivre un mois !
Ce penchant pour un humain l’avait conduit à
modifier ses habitudes alimentaires mais il n’avait
pas oublié la saveur d’une viande digérée
lentement, et Mathurin décela un léger regret
dans sa remarque. |
| |
 |
CRÉPUSCULE
À VENISE |
 |
| |
Il
y a bien longtemps, j’ai fait un pacte avec la mort.
Après avoir signé de mon sang au bas d’un
parchemin, j’ai vécu dans l’opulence et
dans la plus parfaite insouciance. On envie ma flotte marchande,
armée et puissante, la magnificence de mes palais,
et ma fortune colossale, bien au delà de la Vénétie.
Je ne compte plus les bals que j’ai donnés, les
fêtes auxquelles j’ai participé. Mes conquêtes
? Les femmes les plus séduisantes ! Mais elle n’a
pas honoré le contrat, une maladie me ronge. Mes chairs
se gangrènent chaque jour davantage, mon visage me
terrifie, je dois porter un masque. Elle m’a donné
rendez-vous ce soir. |
| |
 |
ARRÊT
SUR IMAGE |
 |
| |
À
ce moment, la lumière devint violente. J'étais
devant la porte de Lisbeth et elle m’ouvrait. J’avais
dû sonner...
— T’en fais une tête ! On dirait que tu
sors d’une tombe…
— Non, dis-je en serrant fortement une bouteille de
champagne contre ma poitrine. Je m’étais échoué
chez les Maoris…
— Rentre ! dit-elle. Je ne comprends rien à ce
que tu me racontes !
C’était agaçant, Lisbeth ne voyait que
ce qui l’arrangeait. Elle voulut me prendre la bouteille
des mains mais je m’y accrochais comme à une
chaloupe. Elle insista et la bouteille se brisa, me laissant
une belle entaille dans le pouce. Elle ne faisait jamais les
choses à moitié Lisbeth... Je fus presque content
de voir mon sang couler, il m’en restait encore, les
Maoris de la brume ne m’avaient pas tout pris.
— Regarde ce que tu t’es fait ! Je vais te soigner
avant que ça s’infecte !
Pauvre Lisbeth… si gentille. Il y avait bien longtemps
que j'étais infecté, je ne risquais plus grand-chose.
D’ailleurs, je me sentais immunisé contre tout,
probablement parce que je ne l’étais contre rien.
|
| |
 |
UN
DOIGT SUR MES LÈVRES |
 |
| |
La
nuit était fraîche. J’avançais lentement
sous les arcades, le clapotis de l’eau contre les murs
me berçait, mon esprit vagabondait. Je songeais à
Marco Polo, à ses bateaux s’éloignant
dans la brume pour une Chine dont personne ne savait grand-chose,
sinon que cette épopée plongeait tous ces marins
dans le plus suspect inconnu.
Un cri horrible, à quelques pas de là, suivi
de gémissements aussi atroces me sortit de ma torpeur.
Une femme venait d’être agressée. Je m’approchai
d’elle. Une odeur âcre se dégageait de
ses vêtements, celle de la chair brûlée
me souleva le cœur, elle avait reçu un acide en
plein visage. Désireux de l’aider, je me ressaisis
mais avec, à cet instant, la conviction qu’elle
resterait défigurée. Il me sembla qu’elle
était jeune. À ses pieds, une bourse arrachée
et quelques ducats d’or qui renvoyaient la lumière
de la lune. Ma première idée fut de la transporter
chez un alchimiste de mes amis qui logeait à quelques
rues de là, mais je ne pouvais compter sur sa coopération,
elle avait perdu connaissance et je devais la porter sans
être moi-même brûlé. Je l’enveloppai
dans ma cape et, en la prenant dans mes bras, je découvris
l’une de ses épaules sans le vouloir. Elle portait
un tatouage, un symbole dont je ne connaissais pas la signification,
mais ce n’était pas ma préoccupation première.
Pourtant, j’avais vu les pires mutilations pendant la
campagne contre les Ottomans mais ce visage ravagé
me troublait profondément. Un sentiment d’impuissance
me parcouru. |
| |
 |
LE
MAÎTRE D’ŒUVRE |
 |
| |
La
chaleur était insupportable, des chauves-souris swinguaient
comme des folles devant la croisée, le ciel n’annonçait
pas la pluie, rien ne pourrait lui rendre sa bonne humeur
! Lorsque vers trois heures du matin les voitures cessèrent
leur vacarme, il perçut des bruits insolites dans la
maison. Plus la nuit avançait, moins il parvenait à
dormir. On marchait dans l’escalier, il l’aurait
juré. Il ouvrit brusquement la porte pour surprendre
l’intrus mais il n’y avait personne. Juste lui,
et la chauve-souris qui renouvelait son show d’enfer
accompagné cette fois par une chouette à la
basse. Ce bruit au grenier l’obsédait. Muni d’une
lampe torche, il gravit les quelques marches, un homme d’une
cinquantaine d’années s’était installé
sous les combles et dînait.
— Qui êtes-vous ? demanda Dimitri.
— Je suis le maître d’œuvre. Tiens,
c’est vrai ! Je ne vous avais pas encore vu ! répondit-il
calmement.
— Le maître de quoi ?
— Le maître d’œuvre ! Je suis responsable
de la construction de la maison, c’est moi qui dois
rendre compte au propriétaire.
— Mais… elle est terminée depuis 1865 !
Et nous sommes en 2001 ! s’exclama Dimitri.
L’homme ne parut pas entendre. Il se pencha sur le plan,
invitant Dimitri à l’examiner avec lui à
la lumière d’une bougie :
— Ah oui… reprit-il en se redressant, je tenais
à m’excuser par avance car nous allons faire
un peu de bruit dans les prochains jours ! Demain, j’attends
les pierres blanches des carrières de la Seine, ce
sera un peu volumineux… puis les grosses meulières
pour la partie supérieure. Après-demain, ce
sera les briques, pour les parties intermédiaires,
il y en aura plusieurs tonnes. À la fin de la semaine,
nous recevrons les madriers… pour le plus gros du bois.
— Je crois que vous n’avez pas bien compris !
Elle est construite ma maison ! Elle est finie depuis longtemps
!
— …
|
| |
 |
LES
GARDIENS |
 |
| |
Elle
pénétra dans la pièce où il avait
vécu, si froide maintenant. Elle déplaça
du courrier et voulut ranger des papiers dans le chiffonnier
; l’un des tiroirs résistait, elle le força
avec un tournevis. Il contenait divers dépliants sur
le lac Majeur et un sur celui d’Orta, un portefeuille
usé, des cartes routières et une chemise cartonnée
bleu délavé qu’elle ne connaissait pas,
ornée d’enluminures comme les anciennes polices
d’assurance. Elle l’ouvrit, c’était
bien un contrat. Il avait été souscrit et payé
l’année de sa naissance, un tarif indécent
comparé aux ressources de ses parents. Le document
validé par leur signature était à l’en-tête
d’une société de gardiennage céleste,
un salaire pour deux gardiens dont la mission était
de préserver une portion de son enfance, une portion
de temps qui devait rester matérialisée ! Agathe
ne comprit pas de quoi il s’agissait. Elle referma la
chemise. Pourquoi ne pas lui en avoir parlé lorsqu’il
en était encore temps ? |
| |
 |
RÊVE
PARTI |
 |
| |
Elle
l’avait poussé jusqu’au boudoir avant qu’il
réalise qu’elle ne l’écoutait pas.
Celle-ci semblait plus calme que les autres pourtant, elle
s’enroula dans une tenture en poussant des petits cris
de cochon d’Inde. La tringle de cuivre se mit à
osciller doucement ; il allait aimablement l’en aviser
lorsque le lourd rideau tomba, la recouvrant complètement.
Le bruit de la chute fit accourir les gens de maison ; une
intendante apparut, un calepin à la main : «
S’ils s’obstinent à grimper aux rideaux,
il ne restera bientôt plus rien d’authentique
ici. Encore un vieux machin qu’il va falloir changer
! »
Eymard n’avait qu’une idée, regagner le
salon. La girafe mécontente lui fit un croche-pied
et il se cogna le front sur le marbre d’une cheminée.
|
| |
 |
JANE
ET LE SERPENT |
 |
| |
Elle
pénétra dans l’entrepôt. Il y régnait
une atmosphère étouffante, la clim ne fonctionnait
plus. Les serpents essayaient de quitter leurs terrariums,
la faim et la chaleur avaient modifié leur comportement.
Eux si paisibles d’habitude essayaient par tous les
moyens de sortir de leurs cercueils de verre. Elle prit son
préféré, un serpent couleur sable, et
lui chuchota : « Ted n’est plus là mais,
ne t’inquiète pas, je vais m’occuper de
toi. » Elle sortit, récupéra un sac caché
sous l’abreuvoir et en vérifia le contenu ; le
compte des dollars semblait y être et la télécommande
aussi. Elle activa le bouton rouge, le bâtiment se désintégra
et un morceau de bois s’encastra à l’arrière
de la voiture pendant que le serpent s’endormait autour
de son cou.
Elle attendit quelques minutes, rangea les liasses de billets
sous le tableau de bord et Ted dans le lot de ses souvenirs
pas très recommandables. Un amour truqué, basé
sur le mensonge, disparaissait au milieu des cendres et des
excavations provoquées par l’explosion. |
| |
 |
NUIT
APACHE |
 |
| |
Un
jour, elle lui jeta un cochon sauvage, vivant, auquel elle
avait entravé les pattes, sans descendre de son cheval.
— Venez donc le partager avec moi, je suis bon cuisinier.
Ce soir… par exemple ! cria-t-il.
Ses mots se perdirent dans le vent, elle était déjà
loin. Avait-elle entendu ? Après tout, qu’elle
continue à faire la gueule ! Je ne lui ai rien demandé.
Il n’avait pas fui ses semblables pour reconstruire
des querelles stériles. S’affranchir des contingences
sociales, c’était ça l’avantage
des conditions extrêmes. Si elle voulait venir, elle
n’aurait qu’à suivre le fumet de la viande.
La nuit était tombée quand des branches craquèrent
derrière lui. Il ne l’avait pas vu descendre
de son cheval. Il se retourna, elle était déjà
assise en tailleur à côté du chien jaune
qui leva la tête et se rendormit, comme si sa présence
était naturelle. Phil remarqua qu’elle ne portait
pas d’arme. La lumière du feu de camp allongeait
les ombres et faisait danser les couleurs ; la belle devait
être frugivore, ses lèvres avaient le reflet
mauve des baies qui poussaient alentour. Il lui tendit un
morceau de viande qu’elle dégusta lentement puis,
brusquement, elle prit sa monture et s’éloigna
sans avoir dit un mot.
|
| |
 |
GASPARD |
 |
| |
Chaque
jour, la garde impériale de ses souvenirs ajoutait
un peu de brume dans sa mémoire, le projetant dans
l’oubli au crépuscule de sa vie alors, le marquis
Fabien de La Glass s’astreignait régulièrement
à tracer d’une écriture tremblante quelques
pages du récit des excès de ses années
de jeunesse. Il aurait pu faire l’historique de sa vie
rien qu’en comptabilisant les jupons multicolores qui
défilaient devant ses yeux, linceuls parfumés
de souvenirs dont les contours s’estompaient avec les
années. Fabien cohabitait avec Gaspard, un gros rat.
La tête penchée sur les feuillets, comme un enfant
studieux répétant ses leçons, le rat,
prodigieusement intelligent, apprenait par cœur ce que
le prisonnier écrivait. Un banc, une paillasse et une
table, qu’ils débarrassaient à tour de
rôle des quelques déchets s’y accrochant,
meublaient la cellule des deux compagnons d’infortune.
Dehors, les flocons enveloppaient les barreaux, montrant au
ciel qu’un lieu de réclusion pouvait être
esthétique. L’hiver 1787 était glacial. |
| |
 |
OLIVIER
ET LE CAPUCIN |
 |
| |
La
rue de Rivoli était déserte, seules quelques
voitures grises prouvaient que Paris n’avait pas été
amputé. Au quatrième étage d’un
immeuble cossu, allongé sur un lit, les yeux mi-clos,
Olivier ne prêtait que peu d’attention au moine
capucin engoncé dans sa robe de bure qui lisait sans
s’interrompre de longs et ennuyeux passages de la Bible.
Le capucin s’appelait Pierre, un prénom prédestiné
pour une telle besogne. En grimaçant, Olivier dit à
voix basse : « Vous faites beaucoup d’efforts
pour rien. Je suis un impie, vous ne parviendrez pas à
racheter mon âme. » Il eut un petit rire, pas
même nerveux, et ajouta : « Que voulez-vous en
faire ? L’offrir au panthéon d’un monde
qui respire les ailes odoriférantes des anges en s’endormant
? » Le moine capucin fit semblant de ne pas entendre
et tenta de rompre le climat de désespérance
qui régnait dans la pièce :
— Puis-je vous poser une question ?
— Faites, dit Olivier.
— Pourquoi êtes-vous ainsi vêtu ? Ce vêtement
en tissu grossier n’est pas un pyjama… Et cette
cotte de mailles, cette épée à deux tranchants…
Pourquoi ce heaume posé sur la table de nuit ?
Olivier ne répondit pas. Il se livra simplement à
une évocation de souvenirs charmants et odorants :
des mains de jeune fille décorées de dessins
au henné… des fleurs de jasmin, d’hibiscus
et d’oranger... puis il se mit à trembler.
|
| |
 |
LES
SOULIERS DE MURANO |
 |
| |
À
contre-jour, Louisa observait le pauvre bougre en buvant une
eau rafraîchie. Il s’enfonçait lentement
dans sa beuverie, elle attendit qu’il fût à
point :
— Puis-je m’asseoir ?
— Vous pouvez tout ce que vous voulez ! Je vous accorde…
tout !
— Accompagnez-moi à Murano !
— Je vous accompagnerais en enfer si vous me le demandiez
!
Et il tomba de sa chaise. Il fallut l’aide de plusieurs
hommes pour le relever. Le lendemain matin, il ronflait encore
sur la table quand Louisa apparut dans l’encadrement
de la porte, vêtue d’un ensemble noir un peu strict
orné de boutons brodés qui rehaussaient sa poitrine.
Les premiers coups de maillet marquaient le début de
la journée. Une calèche attendait sur le seuil.
Louisa souleva la tête d’Emilio :
— Vous souvenez-vous de votre promesse ?
— J’ai promis ? Par l’Empereur, qu’ai-je
bien pu vous promettre ? Je ne vous connais pas et il ne me
reste rien. Ni argent, ni honneur, j’ai même perdu
mon casque !
— …
— Qui êtes-vous, la fille d’un doge ou d’un
évêque ayant péché ? Mais peut-être,
êtes-vous riche ! Épousez-moi… épousez-moi
pour que je redevienne un être humain !
— C’est cela ! Mais avant toute décision
hâtive, vous devez tenir votre promesse et m’accompagner
à Murano. Mes chaussures de verre sont en mauvais état,
il m’en faut des neuves.
— Des chaussures de verre ? Alors ça… mais
personne ne porte des chaussures de verre !
Louisa sourit. Lui faisait-il pitié ce petit cavalier
sans cheval, sans lance et sans casque, et d’après
lui, sans honneur ? Ou bien était-elle en train de
tomber amoureuse d’un témoin de la grandeur d’un
empire ?
|
| |
 |
PARCOURS
FLÉCHÉ |
 |
| |
Il
avait rendez-vous devant le hangar d’un terrain d’aviation
civile. Un quart d’heure puis une demi-heure passèrent.
Il poussa machinalement la porte. L’intérieur
était presque vide, excepté au fond où
s’enchevêtraient d’énormes cages
métalliques. Il s’approcha.
— C’est bizarre ! dit-il à haute voix.
Ces oiseaux ont des têtes humaines…
Un menu spécifiquement établi était accroché
sur la porte de chaque cage, un régime alimentaire
équilibré, voire diététique, pour
chacune de ces drôles de vies. Une impression de perfection
se dégageait de l’endroit et personne n’avait
l’air surpris d’être enfermé en ces
lieux. Qui joue ici les apprentis sorciers ? pensa-t-il.
|
| |
 |
L’OURS
BLANC |
 |
| |
Sans
réfléchir, Alex empoigna l’ours blanc.
Il quitta l’étage sans passer par la caisse et
l’idée qu’il pouvait se faire coincer au
dernier moment l’effleura à peine. Il sortit
sans encombre. En arrivant chez lui, il l’installa dans
un fauteuil. Ils se regardèrent. Un demi-siècle
plus tard, il s’entendit prononcer : « Maintenant,
tu ne me fais plus peur ! » On dit parfois des choses
idiotes.
Au fil des semaines qui suivirent, il se sentit de plus en
plus fatigué. Le résultat des analyses était
sans appel, il était gravement anémié.
Si la cause en était inconnue, l’asthénie
qui le clouait au lit était bien réelle et le
rapprochait, inexorablement, de ce qu’il voulait ignorer.
Chaque jour, Cécile lui tenait compagnie pendant quelques
heures ; parfois, elle s’installait chez lui pour un
moment et il se sentait en sécurité. Elle rédigeait
des manuels pour un institut de physique nucléaire
et, pour le distraire, elle lui parlait d’ions excités
lors de collisions avec des atomes, de particules fantômes
et de cyclotrons en goguette. Cela le faisait parfois sourire,
mais en règle générale, ses explications
entraient par une oreille et ressortaient par l’autre
; sa formation littéraire n’accrochait pas aux
démonstrations scientifiques. Il n’avait que
ça comme excuse.
|
| |
 |
ENTRE
JOUETS ET JEUX DE GUERRE |
 |
| |
Ici,
ce n’est pas vraiment la guerre. Ce n’est pas
la paix non plus. Tout est tellement différent de ce
qu’il avait imaginé en posant le pied sur ces
hauts plateaux. En ces lieux qui peuvent à peine porter
le nom de village, il n’y a plus de grands guerriers
; il ne connaît que des survivants terrés dans
des grottes, une humanité désaccordée
qui essaie encore de trouver sa place.
En attendant un assaut, il répare des montres, des
jouets, souvent des ustensiles ménagers, parfois des
armes qui paraissent sorties d’un musée imaginaire.
Dans les moments d’accalmie, instants de grâce,
il raconte aux petits des histoires auxquelles il ne croit
plus. La magie des mots enrichit leurs yeux de bonheur, éphémères
distractions ! Puis, sous le regard fasciné des enfants
qui affectionnent les intermèdes qui modulent le temps,
il sort de sa trousse de cuir élimé une petite
boîte de métal brillant pour se soigner. Il se
déboîte un genou, rajuste minutieusement un microprocesseur
ou s’ouvre la jambe pour changer une puce, des réfections
douloureuses sur des nerfs exacerbés. De savants outils
aux pointes cruciformes et des batteries miniatures composent
l’infirmerie du militaire du troisième millénaire
!
C’est ainsi qu’Archimède vit, s'accommodant
d’un corps parsemé d’électronique
qu’un cerveau humain met en mouvement.
Ensuite, il scrute encore l’horizon. Ce n’est
pas la ligne bleue des Vosges mais un conglomérat de
cimes arides sur lesquelles se déplacent des rebelles
qui se doivent de survivre. |
| |
 |
L’HOMME
SANS NOM |
 |
| |
Sans
but précis, il remontait lentement le quai vers la
sablière abandonnée où s’affaissaient
quelques cônes de gravier, logeant ses pas dans le charme
d’une neige encore intacte. En contrebas, les flocons
criblaient de fleurs d’eau le fond d’une péniche
; l’homme trouva ça beau. Sans les grues inertes
qui martyrisaient la perspective, il aurait peut-être
trouvé ça parfait. Un enfant lui mit quelque
chose dans la main. Il ne l’avait pas vu arriver.
— Creuse ! C’est mes parents !
Le gamin fixait les monticules avec insistance.
— Mais creuse puisque je te dis !
Des semelles détrempées affleuraient une sépulture
improvisée ; l’histoire aurait voulu cacher ce
que le présent s’empressait de décrire.
L’homme hésita. S’il ne savait plus qui
il était, il avait encore des réserves d’habitudes,
d’attitudes pour les autres alors, pour faire plaisir
à un petit bout d’homme obstiné, l’homme
sans nom creusa sans réfléchir. Il dégagea
deux corps : un militaire en uniforme étranger et une
femme avec un manteau cintré garni de fourrure au col
et aux poignets, un vêtement élégant malgré
le sable qui le souillait. Ils étaient serrés
l’un contre l’autre, le regard imprégné
de terreur ; tellement serrés que l’homme pensa
qu’un seul cercueil pourrait suffire.
|
| |
 |
BRÈVE
BLANCHE |
 |
| |
En
revenant, j’ai croisé de drôles d’êtres.
Tout le monde a l’air de dire qu’ils sont arrivés
ce matin. Ce doit être vrai car il fait beaucoup plus
froid. Ils ressemblent à des bonshommes de neige. Sans
en être. Curieux…
Le ciel est bas. Il n’y a pas de vent. Pas de bruits
d’oiseaux non plus.
J’ai croisé un pauvre curé de campagne,
triste et voûté. Je me suis demandé ce
qui lui faisait cet effet-là… |
| |
 |
SI
BELLE ! |
 |
| |
Elle
était belle, insouciante, amoureuse ; il ne comprit
que bien plus tard que c’était de lui.
Elle l’embrassait délicatement de ses lèvres
charnues, gorgées de pollen, et il sentait une caresse
veloutée sous son nez, sur la lèvre.
Son corps annelé avait la douceur de la soie et le
goût des pêches bien mûres. Lorsqu’elle
se pressait contre lui, un étrange fluide le pénétrait.
Après des minutes d’amour intense, enveloppé
dans ses ailes, il se sentait vivifié, prêt à
mille folies.
En voyant, au matin, la fenêtre ouverte, il savait qu’elle
était partie. De douces exhalaisons, cassis et fraise
des bois, flottaient dans l’atmosphère ; alors
il tirait doucement les persiennes pour retenir encore ce
trésor olfactif.
|
| |
 |
NOUVEAU
MONDE |
 |
| |
Je
me souviens que nous avions quitté Nantes par un de
ces matins brumeux qui ramènent au sol les bonnes comme
les mauvaises odeurs. Nous partions sans regret. La prospérité
de la mine d’or que nous avions acquise ne faisait aucun
doute et nous nous sentions déjà riches. Après
une traversée chaotique, nous dûmes parcourir
bon nombre de miles pour atteindre la ville minière,
une cité fantôme, sordide, aux odeurs fortes
de bois putréfié et de tourbe provenant des
terres abandonnées. Il nous fallut une bonne dose de
perspicacité pour repérer notre lourd passif
puis, notre lucidité mesura la disproportion de notre
acquisition. Notre cauchemar européen se prolongeait
dans une déplaisante lenteur de fin d’époque.
Le soir tombait, il ne nous restait qu’à dormir
pour affronter le lendemain.
Au matin, il nous sembla que le décor s’était
transformé pendant la nuit. Si nous avions pu vendre
la poussière au prix de l’or, la fortune était
sous nos pieds.
|
| |
 |
CRESCENDO,
DECRESCENDO |
 |
| |
Il
était vingt-trois heures cinquante-huit quand mon cœur
s’est arrêté de battre. Pour n’importe
qui, cela signifierait mourir pourtant je continue à
vivre. Désormais, la réalité ne m’aveugle
plus. Nous n’existons pas, nous croyons être !
Ballottés entre des mains invisibles, nous ne sommes
que des impressions qui se perdent dans l’immensité
d’un ciel qui seul détient le secret.
Depuis que les battements de mon cœur ne se font plus
sentir, mon attention s’attarde sur mon bras droit qui
me fait, par moments, terriblement souffrir. La douleur va
et vient, comme un leitmotiv. En retroussant la manche de
ma chemise, je découvre, fixé dans mes chairs,
un beau crustacé rouge orangé avec de légères
traces violines qui lui donnent son caractère et sa
spécificité. Je m’empresse de le montrer
à mon médecin qui, compétent, me dit
immédiatement :
— Vous avez le mâle de quinze heures ! C’est
peu fréquent. C’est une maladie orpheline que
j’ai rarement diagnostiquée. Je ne vous poserai
qu’une seule question : avez-vous moins mal après
quinze heures ?
— Oui, bien sûr !
— Cela correspond à la description de mes ouvrages.
C’est parce qu’il desserre ses pinces à
ce moment-là ! Ainsi, la crise diminue... decrescendo !
|
| |
 |
EN
ROSE ET VERT POMME |
 |
| |
Lorsque
le juge en robe rose et vert pomme lui demanda : « Jurez-vous
de dire la vérité, toute la vérité,
sur la bible ? » Félix murmura machinalement
: « Excréta… » Il ne s’y attendait
pas. Il n’avait jamais lu cet ouvrage, capital au dire
de certains. Une fois de plus, il était sous les projecteurs.
C’est parce que le juge, avec son lapin blanc autour
du cou et ses bouclettes blondes sur la tête, faillit
s’étrangler qu’il se sentit obligé
d’expliquer :
— Je ne connais pas mes origines. Je suis une substance
rejetée depuis ma naissance. Enfant, je fus marqué
par l’utilisation étrange que mes parents faisaient
de deux petits arbres généalogiques calcinés
posés sur leurs tables de nuit. Ma mère y pendait
ses bagues et mon père y écrasait ses mégots
! Mais pourquoi parler de parents puisqu’ils m’avaient
acquis pour une modique somme dans une humanité…
un endroit plutôt rébarbatif puisqu’on
y pratiquait l’auto-euthanasie. Les plus chanceux, ceux
qui avaient les moyens, pouvaient mourir lentement…
moyennant finance, car les drogues coûtaient déjà
fort cher à cette époque. Mais, je vois bien
que cette histoire vous passe au-dessus de la tête.
Dans le fond, je ne sais même pas de quoi je suis accusé
!
Le juge en robe rose et vert pomme eut pendant une fraction
de seconde de la compassion et certains de ses collègues
froncèrent les sourcils en guise de reproche.
— C’est encore moi le juge ! hurla-t-il, probablement
dans une poussée de diabète puisqu’un
instant après, soudainement, il se calma.
Son visage passa du carmin à un rose normal, s’accordant
nettement mieux avec sa robe, puis il reprit en s’adressant
à Félix :
— Je vous dois la vérité. Vous êtes
ici parce que vous n’avez pas d’histoire. Il n’y
a aucune trace de vous, vous êtes coupable de non-existence.
Bref, vous n’avez pas un cursus normal ! Vous êtes
en dehors, au-delà de toutes les références.
Avant de vous juger, nous avons essayé de vous trouver
des excuses mais vous n’en avez pas ! Pour nous, vous
êtes une espèce de non-être !
|
| |
 |
NE
JAMAIS FAIRE CONFIANCE |
 |
| |
Jeannot
regarda la postière appuyer son vélo contre
la grille. Elle avança jusqu’à la porte
et cria :
— Y’a quelqu’un ? J’ai du courrier
pour un certain Jeannot.
Il y avait bien des années qu’un tel évènement
ne s’était pas produit. Il savait bien Jeannot
qu’il y avait quelqu’un mais il hésita
; son faciès couvert de poils lui laissait peu de possibilités
mais il fallait circonscrire les braillements de la préposée.
Il passa un épais passe-montagne et d’un bref
coup d’œil dans la glace, vérifia que la
fente de sa lèvre supérieure était cachée.
Il trouva l’oblique de ses yeux encore trop visible
mais sa curiosité restait son seul luxe alors, il mit
des gants, prit les clefs maculées de rouille et cria
:
— Voilà, j’arrive !
— C’est pas trop tôt ! grommela la femme.
Il entrebâilla le portail, saisit la pile d’enveloppes
et donna une pièce qu’elle lui rendit brutalement
:
— Elles n’ont plus cours depuis des lustres !
Quand c’est comme ça, vaut mieux rien donner !
Pour une reprise, c’était raté, mais il
ne ressentit pas de colère ; elle avait raison, c’était
bien lui qui avait décroché les wagons de la
loco.
Toutes les lettres venaient de Californie, des réponses
à des castings, certains vieux de vingt ans. Il en
prit une au hasard. |
| |
 |
PAUVRE
MARTIN |
 |
| |
Pour
la première fois, Martin posait seul les pieds sur
l’établi. Il ressentit du plaisir. C’était
donc cela être heureux ! Mais il pressentait que d’autres
notions restaient à acquérir. Après quelques
pas hésitants, il se sentait devenir. Mais devenir
quoi ? Il n’était plus vraiment un jouet mais
il n’était pas un humain pour autant. Difficile
de mettre une étiquette sur sa petite vie ! Plus il
pensait, plus il savait que tout allait se compliquer mais
il ne pouvait plus faire marche arrière. Il enfila
une petite veste de velours bleu canard et des souliers vernis
noirs avec une boucle dorée qu’il trouva dans
un carton. Ainsi vêtu, il ressemblait à un petit
prince. Un prince des jouets ! Il franchit la porte, une voiture
pie de la police passa ; elle ressemblait à un modèle
réduit. Le maître des jouets le regarda heurter
une poubelle puis un réverbère sans bouger.
Martin l’inutile parcourut quelques mètres ;
il avait gagné la liberté et perdu l’insouciance.
Maintenant qu’il évoluait au milieu de la foule,
son corps manquait de précision. Il découvrait
que ce créateur si sûr de lui n’était
pas irréprochable ; certaines pièces étaient
imparfaites. Martin revint sur ses pas et posa sur lui un
regard lourd de reproches. Que de souffrances il avait endurées
quand une pièce mal calibrée ne s’ajustait
pas au premier essai ! Il s’était abandonné
entre ses mains, il lui avait accordé sa confiance
mais il avait été trompé. Combien de
fois avait-il regardé, les yeux pleins de gratitude,
le maître des jouets pendant qu’il l’assemblait
? Aujourd’hui la porte claquait sur le tréfonds
d’une illusion qu’il avait entretenue. |
| |
 |
LE
VOYAGE DE LA MANDRAGORE |
 |
| |
Il
avait élu domicile dans la mansarde d’un meublé
tenu par une femme étrange, fière et ombrageuse,
qui ne fréquentait personne. Il émanait d’elle
des effluves de fleurs et d’iode ; la senteur du vent
dans les ajoncs nimbait tous ses mouvements. Depuis bien des
années, il n’avait entendu du son de sa voix
que de brefs : « Tiens, Lucien, voilà ton Chouchen
» ou bien « Garde la clef de la porte de derrière
si tu rentres tard ce soir » mais pour un marin plus
habitué au cri des mouettes et des fous de Bassan qu’aux
conversations de salon, c’était suffisant. Alors,
qu’un soir différent des autres, l’histoire
se prolonge dans la tiédeur d’un lit, c’était
prévisible. Un regard, une main tendue, les gestes
malhabiles d’une première fois, malgré
leurs étreintes, le corps souple de la belle était
resté froid et humide et il avait eu l’impression
de vivre une histoire entendue autrefois. Il n’était
pas
causant, Lucien ! surtout pour des sujets aussi intimes pourtant,
le lendemain, il raconta son aventure à son associé,
Awen, qui parut effrayé :
— Paour kaezh ! Tu as couché avec elle ! Ça
se voit que tu n’es pas d’ici… Tu dois avoir
perdu la raison !
— Qu’a-t-elle de particulier cette femme ? demanda
Lucien, pas plus éclairé.
|
| |
 |
COMME
UN GRAND VIDE |
 |
| |
Un soir de brouillard, dans une brasserie,
un homme rencontré au bar avait raconté à
Max une bien curieuse histoire :
— Avez-vous entendu parler de la vallée des hommes
perdus ? avait-il demandé.
Et sans attendre la réponse, il avait poursuivi :
— Il paraît que des êtres sans attaches
y errent au gré des saisons. Selon un choix arbitraire,
chaque année, l’homme des douleurs est désigné
pour passer un an auprès d’eux, ou plus, selon
sa détermination. Ceux qui ont connu des expériences
comparables aux leurs savent les accompagner longtemps. J’ai
rencontré un jour l’un de ces désignés
d’office. Assis sur un banc de pierre du jardin des
Trinitaires, il répétait une interminable litanie.
C’était insolite ! Je crois en avoir retenu
l’essentiel...
|
| |
 |
VOTRE
PRÉNOM ? « ORCHIDÉA... » |
 |
| |
Tout
a commencé le jour où j’ai bu l’eau
des fleurs. Enfin, ce que contenaient de longues éprouvettes
qui traînaient dans la serre de mon amie Cathleen !
C’était beau. C’était coloré.
Tentant. Je n’ai jamais pu résister aux couleurs
franches ; on a tous des petits travers. Je n’ai jamais
su non plus qui je devais remercier, de Dieu ou du diable,
pour m’avoir permis de commettre cet acte irréversible.
Depuis, je me sens très différent. Certains
croient que j’abuse de paradis artificiels mais pour
voyager, je n’ai pas besoin de cela ! Mon imagination
m’a toujours aidé à franchir des distances
peu communes, m’amenant à discourir avec des
gens que je n’aurais, en d’autres circonstances,
jamais croisés. Au fur et à mesure que le liquide
descendait dans mon tube digestif, je découvrais des
perceptions nouvelles, mon être s’éclairait
de l’intérieur. Mes semblables, toujours pressés,
avaient oublié les multiples détails qui m’apparaissaient
maintenant : des organismes savaient vivre sans affolement
et n’en étaient pas affectés. Cette mode
de la vitesse ! Leur frénésie à vouloir
réduire les distances me conduisait à déduire
qu’ils ne quittaient jamais le point d’où
ils essayaient de partir.
J’avais bu l’eau des fleurs, je me sentais différent
; mais cela ne m’apaisait pas car, différent,
je l’avais toujours été. Les jours passaient,
le besoin s’affirmait, je devais absorber les autres
flacons et c’est ce que je fis. |
| |
 |
L’HOMME
PERFORÉ |
 |
| |
Depuis
plusieurs jours, il percevait une présence. Un curieux
petit être le suivait pas à pas. À la
terrasse d’un café, au restaurant, dans la foule,
il se sentait observé mais s’il se retournait,
le petit bonhomme avait disparu. L’idée qu’il
n’aurait pas dû faire certaines photos et, encore
moins les vendre, germait dans son esprit. Le cliché,
pris au Vietnam, d’une fillette avec une jambe arrachée
revenait sans cesse le hanter. D’autres l’obsédaient
également mais, c’était son job ! Pourquoi
cet argument ne l’apaisait-il que momentanément
?
Un soir, après la fermeture, il resta seul dans la
galerie qui présentait une rétrospective de
sa carrière ; l’expo attirait un public quasi
fanatique. Dans la pénombre, il resta figé devant
des images qui jusque-là ne l’avaient pas choqué.
Maintenant, il comprenait qu’il avait pansé des
plaies gonflées par l’infection. À l’angle
opposé, assis sur un tabouret, le petit curieux le
scrutait. Steve demanda, agacé :
— Que fais-tu ici ? Que veux-tu au juste ?
|
| |
 |
L’ENFER
DU DÉCOR |
 |
| |
Nicéphore ne savait plus depuis
combien de temps il était assis au bar, devant cette
énorme chope d’alcool. Mort à sa vie,
à sa créativité, à sa soif d’expliquer
! À ses amours en lambeaux. Tout cela se résumait
en petites bulles mordorées qui montaient et descendaient
sans cesse. À ce degré d’éthylisme,
il faisait même des paris sur elles : la petite rattraperait-elle
la grosse ? Il piétinait de joie quand l’une
d’elles en percutait une autre et que, de cette fusion,
naissait une grappe lumineuse. Lorsque, fatigué, il
posait son nez sur le bord de l’édifice de son
désespoir, des petits chuintements lui chatouillaient
les narines. C’était tellement agréable
de n’être plus vraiment là, seul avec ces
petites femelles bondissantes ; mais après tout, pourquoi
ces bulles seraient-elles du sexe féminin ? Il savait
quand commençaient ses délires, jamais quand
ils finissaient.
La lumière ne traversait plus son verre ; il hissa
ses yeux, aidé de ses pouces, au-dessus du liquide.
Un personnage étrange, dans un costume étriqué,
le regardait, le fixant de ses yeux noirs bordés d’une
épaisse moquette :
— Vous voulez voir mes papiers, monsieur le croque-mort
? demanda Nicéphore.
|
| |
 |
PIÉGÉ |
 |
| |
Comme
dans un film carré de José Giovanni, le vent,
la mer, le ciel rouge sur les calanques étaient désormais
le décor d’une tragédie qui se mettait
en place. Requiem pour deux cons, deux êtres qui n’avaient
su que se faire souffrir ! Depuis la nuit des temps ils étaient
soudés, Adrien le savait maintenant ; ils avaient vécu
leur époque romaine, puis un Moyen Âge obscur,
et le Siècle des lumières avait fini par les
engloutir dans l’immensité d’un univers
dont personne ne sort indemne. Le Qui sommes-nous ? Où
allons-nous ? prenait un sens mélodramatique. Ils avaient
aimé si peu que gâcher la dernière scène
leur semblait avoir, cette fois, un sens.
Adrien s’assit devant Richard. Il connaissait tout de
lui, Richard ne pouvait pas le berner. Et il le savait. Alors,
maintenant, tous ces non-dits avaient déjà un
parfum post mortem. Richard lui demanda ce qu’il buvait.
Adrien faillit répondre : « Je ne bois plus,
je prends des médicaments », mais cela n’avait
plus d’importance alors, comme autrefois il demanda
un Cuba libre. « Tu n’as pas changé, dit
Richard, toujours la fascination de Cuba. Et je suppose que
tu fumes encore des Cohibas… » Inutile de répondre,
un sourire suffit.
|
| |
 |
LA
SAINT-VALENTIN DU MOUTON |
 |
| |
Le
mois dernier, alors que ma tournée m’avait emmené
bien loin de chez moi, il est arrivé malheur à
mon plus vieux mouton. À mon retour, je l’ai
retrouvé sans vie au milieu de la cour. Sur le coup,
je n’ai pas compris que sa patte avant gauche me désignait
quelque chose – je suis un peu fada, je communique avec
les animaux – et dans la soirée, lorsque je suis
passé au café du village, comme d’habitude,
j’ai eu le malheur de dire :
— Ernest est mort ce matin !
— Ton vieux mouton ?
— Eh oui ! a dit la patronne en continuant à
essuyer ses verres. C’est la bête du Gévaudan
qu’est revenue !
J’ai pensé : Quel imbécile je fais
! Je pouvais pas la fermer et l’enterrer tranquillement…
Il ne manquait plus que la bête de machin chose ! Mais
pour le curé, je ne pouvais pas car à chaque
fois qu’une de mes bêtes nous quitte, il vient
boire son petit verre de Bordeaux à la maison après
avoir béni la « sépulture ».
En fin de journée, les villageois armés de fusils,
de faux et de gourdins – une armée, quoi ! –
débarquaient chez moi. L’Émile s’est
avancé :
— On va te l’attraper ta foutue bestiole et on
va te l’écarteler dans ta cour !
|
| |
 |
DERNIER
RENDEZ-VOUS |
 |
| |
Un
large chapeau recouvrait les yeux de l’homme en noir
en quête de provocation, d’explication ultime.
Une plume rouge tel un jet de sang fragile affirmait sa détermination
à trouver celui qu’il enverrait au tombeau avant
le soir. Il parcourait la ville d’un pas si lourd que
le sol vibrait sous cette puissante machine humaine en mouvement.
La partie obscure de sa vie créait, comme une armure,
l’irrévocable distance qui l’éloignait
d’autrui. Son temps était compté. Il marchait
aujourd’hui à la vie, demain, à la mort
! Il l’espérait parfois, la cherchant dans la
brume de ses délires. Vainqueur à chaque duel,
il n’éprouvait plus de plaisir. Trop fine lame.
Le temps le gardait en vie, le laissait sur sa faim, comme
un dernier baiser qui vous déchire.
Pour défier la mort, c’est à la taverne
qu’il passait les heures précédant un
combat, mais le destin agissait pour son compte, il retrouvait
sa lucidité pour vaincre. Comme un croisé en
quête du Graal, l’homme en noir recherchait l’insolite
pour aggraver le danger mais, même à un contre
trois, il sauvait sa vie et recevait comme une punition les
ovations des badauds pour ce spectacle hors norme. |
| |
 |
LES
TALONS AIGUILLES |
 |
| |
Il
haussa les épaules en passant devant le tronc «
pour les âmes du purgatoire ». Maintenant il voulait
s’en aller mais, au-dessus d’une urne qu’il
n’avait jamais vue, il lut sur une plaque de cuivre
ces mots énigmatiques : « Pour la serrure de
votre vérité ». Cela ne voulait pas dire
grand-chose. Il s’approcha et se pencha avec une légère
appréhension, saisit la clef qui était posée
au fond, mais il ne se passa rien. Il alla s’asseoir
face à l’autel et demanda pardon à sa
mère pour ce qu’il n’avait pas su faire.
Comment aurait-il pu l’empêcher de mourir ! Il
promenait en lui cette énorme tache à l’âme,
un cilice psychologique, un rituel morbide. Le grand mystère
éclabousse les mortels de ses éclats fragmentés
et la justice, dite divine, ne leur octroie aucune latitude
dans les grandes étapes de la vie ! Toujours les mêmes
interrogations : Qui suis-je ? Où vais-je… Il
se sentait rafistolé comme un vieil ours inexorablement
brûlé par le temps.
C’est cette nuit-là, en montée d’adrénaline,
qu’il entendit résonner pour la première
fois dans la cathédrale les talons aiguilles. Il se
retourna et demanda, comme dans un songe, à la femme
cachée sous une cape de velours indigo qui s’avançait
vers lui :
— Est-ce toi, maman ?
Ça sonnait tellement faux qu’il faillit s’étrangler
; il avait toujours appelé sa mère par son prénom. |
| |
 |
LES
HOMMES ARAIGNÉES |
 |
| |
J’allais
dire : C’est la faute de notre instituteur !
Il nous avait tant parlé de ces Indiens d’Amérique,
des cultivateurs pacifiques vivant paisiblement de chasse
et de pêche, que nous avions hâte d’être
arrivés au nouveau monde, terre de toutes les promesses.
J’eus soudain envie d’éclater de rire ;
nous avions vraiment dû manquer tout un pan d’histoire
! L’horreur était à son comble. Avec Aurélie,
nous nous étions réfugiés sous un chariot
renversé au milieu de bâches en flammes. Devant
nous gisaient les corps de nos proches transpercés
de flèches, dont celui de ma mère qui gémissait
encore, attachée sur une roue. J’essayai de réprimer
une pensée horrible ; elle, qui en France parlait abusivement
de sa vie de martyre, allait mourir exaucée. Je me
serais flanqué des gifles pour avoir eu une idée
pareille mais c’était venu sans préméditation.
De l’endroit où j’étais, je distinguais
à ses pieds un homme au crâne rougi de sang,
scalpé ; quelques touffes de cheveux pendaient encore
le long de ses oreilles. Ce n’était pas mon père
; déjà en France, il était presque chauve.
Je n’avais que ce détail pour espérer
qu’il soit encore en vie. |
| |
 |
LE
LIBRAIRE MAGICIEN DE LA RUE CHAPTAL |
 |
| |
Aristide,
le vieux bibliothécaire binoclard de la rue Chaptal,
tenait sous sa coupe un bon millier d’ouvrages anciens.
Ils échappèrent à sa vigilance le jour
où il réussit à extraire Blanche, la
jeune héroïne dont il était tombé
amoureux, d’un grimoire du XVIe siècle, alors
qu’une sale trogne de soudard la poursuivait. Il avait
claqué la couverture au nez de la brute qui avait grommelé
le reste de la nuit. De mémoire de bibliothécaire,
c’était la première fois qu’un personnage
sortait d’un livre pour prendre forme humaine !
Le vieil homme se sentait rajeunir. Toujours d’humeur
égale, elle époussetait les livres et mettait
de l’ordre dans ses fiches. À ceux qui s’étonnaient
de sa présence Aristide répondait que Blanche,
sa nièce, était venue d’Arles pour découvrir
la capitale. Elle devint en peu de temps la confidente de
bon nombre d’habitués et bientôt, plus
personne ne posa de question.
Un matin, de la réserve, elle entendit les échos
d’une altercation. Un homme fort mécontent prétendait
que certains chapitres étaient incomplets ! Cet incident
contraria fortement Aristide, ces affirmations recoupaient
les propos fort surprenants qu’un voisin lui avait tenus.
Il réalisait l’ampleur de ce qu’il avait
provoqué.
|
| |
 |
LISON |
 |
| |
Au
ronflement du 1000 kg Renault, son regard plongea dans la
rue. Il reconnut le camion de Lison. Impossible de se tromper
avec ses plaques indiquant « Antiquaire » de chaque
côté. Il n’avait jamais réussi à
savoir si elle était brocanteuse ou antiquaire, voire
égyptologue, car elle avait pour l’Égypte
ancienne une passion qui lui donnait la capacité de
prendre des risques insensés aux quatre coins du monde.
Quelqu’un l’accompagnait, un homme corpulent qui
tira un brancard du camion puis y déposa un beau sarcophage.
Léo éprouva soudain un malaise. Dans le halo
des réverbères, au milieu de cette nuit insolite,
l’ambiance qui émanait de ce spectacle conditionnait
ses perceptions. Parfois, il avait des flashes et cette nuit-là,
ce fut Lison enveloppée de bandelettes. Elle l’aperçut
et lui fit signe de descendre. Tant que les deux étages
les séparaient, il n’était pas inquiet,
mais déjà, il aurait pu jurer qu’un gros
mensonge se profilait derrière ses yeux angéliques.
Ça sentait furieusement l’arnaque. Lison l’effrontée
avait la faculté de calculer jusqu’où
il lui était possible d’aller, en dévisageant
simplement ses interlocuteurs. Elle savait être persuasive,
malheur à ceux qui l’approchaient de trop près
! Elle était de celles à qui l’on ne s’octroie
pas le droit de dire : Non !
Léo ouvrit la porte, il faisait entrer la louve dans
sa bergerie. De son sourire en forme de petit ruban rose enroulé
autour d’une boîte de chocolats ne s’échappa
pas « Bonjour ! » mais « Peux-tu me garder
ce sarcophage dans ta salle à manger ? Tu es trop chou
! » Elle avait des accents de sincérité
à vous nouer l’estomac. Cela n’empêcha
pas Léo de penser : Trop chou égal trop
con, écoute ton intuition !
|
| |
 |
DE
L’AUTRE CÔTÉ DES BARBELÉS |
 |
| |
Ce
jour-là, l’ouvrage qu’il tira d’un
rayonnage avait une couverture de cuir marquée aux
armoiries de sa famille et une odeur désagréable
de papier jauni. Il s’installa à la table d’acajou
sous la lumière blanche de la lampe et commença
la lecture de ce qui lui semblait être un journal car
le texte était manuscrit :
Moi, Athanase de Crégy, je sais voyager entre rêve
et réalité et quiconque lira ces lignes pourra
y être entraîné.
Suivaient, dans un français ancien, des explications
astronomiques et métaphysiques qu’il trouva confuses
mais aussi énigmatiques car très éloignées
des connaissances du XXe siècle. Il continua cependant
:
Aujourd’hui, 21 novembre 1783, le soleil de Louis,
fripé, peine à se gonfler malgré les
efforts des compagnons mis à sa disposition. Pourtant,
Pilâtre de Rozier met du cœur à l’ouvrage.
Il échange, je crois même, des propos acerbes
avec le marquis d’Arlandes qui lui reproche un manque
de main-d'œuvre pour permettre à la gigantesque
montgolfière et aux hommes qui sont dans sa nacelle
de prendre de l’altitude. Il a été prévu
que le voyage durerait vingt minutes.
Puis son ancêtre racontait que, tout d’abord dans
un étonnement silencieux puis soudain sous les ovations,
la montgolfière s’élevait dans les airs.
Prenant ce spectacle comme une parenthèse, il reprenait
le cours de ses écrits homériques. À
cette lecture, Anthelme eut la confirmation que la réputation
de sa famille n’était pas usurpée. |
| |
 |
DE
SAIGON À LA BAIE D’ALONG |
 |
| |
Sur
la chaussée, ses souvenirs miroitaient au centre d’une
flaque irisée. Tout lui revenait lentement : la remontée
du canal de Suez, les coloniaux replets imbibés de
Fine Napoléon, les chauffeurs de maîtres qui
offraient avec déférence leurs services à
ce jeune officier émerveillé d’avoir basculé
dans un monde dont pourtant, il ne partageait pas tous les
délices. Tout était artificiellement beau, des
couchers de soleil surréalistes donnaient l’aubade
à des levers magiques qu’Ange-Dominique croquait
avec ferveur, consommant ainsi pleinement sa passion pour
la peinture. Son âme se liquéfiait dans ces instantanés
que la photo ne sait restituer. Ces brefs moments de quiétude
voilaient l'ouragan qui se profilait à l’horizon.
Le destin commençait à frapper les trois coups
d’un dernier acte chancelant ; le fléau de la
balance s’inclinait du mauvais côté dans
l'indolence la plus totale. Gonflé des certitudes de
ceux pour qui le plaisir se nichait dans des privilèges
qui coulaient de source, le colonialisme s’affaissait
sur lui-même, comme de gros nuages d’altitude
après l’orage. Cette dépression avait
un nom, Diên Biên Phú, et ses conséquences
firent basculer des acquis fragiles dans la plus sordide réalité. |
| |
 |
ANGUS |
 |
| |
L’hiver
n’en faisait qu’à sa tête, un vent
glacial tailladait les chairs de ses lames effilées
; Angus aurait dit qu’il était trop long s’il
n'avait eu sa bonne femme de neige, cet éphémère
conglomérat de particules de glace, future victime
du printemps. Elle occupait la médiane de son petit
jardin étouffé par des immeubles qu’aurait
sûrement reniés Haussmann. Il l’avait appelée
Bianca, comme sa femme qui l’avait quitté par
manque de persévérance. Elle était devenue
partie intégrante
d’un moi caché entre une pensée débridée
et des souvenirs incrustés et bâtards. Tout cela
n’avait rien de réconfortant, Angus était
bien seul.
Ce matin-là, il rechargea sa batterie pour la énième
fois. Il se pencha à la fenêtre et dégagea
délicatement un faucheux ; Angus ne tuait pas les araignées,
elles jouissaient de tels privilèges qu’il était
difficile de se déplacer dans la maison. Le ciel s’éclaircissait,
il voulait partager avec Bianca leur petit territoire de silence.
Il avait cru la voir bouger. L’immaculée avait-elle
une vie ? Il n’y a pas de vie dans un être de
glace, c’est absurde ! Comme tous mes rêves !
pensa Angus qui n’avait rencontré quiconque pour
les partager. Qu’avait-il de plus ou de moins ? Il ressentait
un tel besoin de dépouillement qu’il avait fini
par s’interdire l’usage de la parole : plus de
questions, plus de réponses. Il rêvait d’un
monde où l’on communiquerait avec les yeux, un
haussement de sourcil pour ceci, un battement de paupière
pour cela… pas vraiment un langage ! Avait-il raison
de vivre ainsi ? Il n’y avait pas de réponse.
Il regrettait encore le jour où il avait rompu son
silence, un spectacle de soi que l’on veut oublier.
La détresse d’une bête blessée au
centre de la meute… un pantin désarticulé
les pieds pris dans la neige qui enfonce… il ne recommencerait
pas.
|
| |
 |
LA
DAME AU CHAT NOIR |
 |
| |
C’est
en pénétrant dans son atelier qu’il réalisa
l’évolution de son mal. Il ferma les yeux pour
s’habituer à la pénombre ; il en avait
gardé le souvenir d’un lieu coloré, tout
était devenu pastel et terne. Il spécula sur
l’idée généreuse qu’il avait
abusé du soleil de l’Orient, certaines ivresses
sont fatales. Sa lumière des délices s’éteignait
lentement de l’intérieur.
Il comprenait maintenant ce qu’il avait gaspillé
autrefois, ce temps que l’on brise en éclats
de frivolité, ces choses précieuses que négligemment
l’on repousse du bout du doigt. Ses pires ennemis étaient
au plus profond de lui, il avait été le jouet
du temps ; sans s’en apercevoir, sa passion, la peinture,
l’avait absorbé. L’âge lui avait
apporté la sagesse mais aujourd’hui, sa vue l’abandonnait
et ses mains, instruments miraculeux de sa créativité,
refusaient de réagir. Sa mémoire projetait ses
œuvres sur l’écran noir de ses paupières,
commandes de princes et de doges, ses mécènes.
Souvent des portraits. Un seul l’obsédait, celui
de sa femme ; elle avait seize ans quand elle avait posé
pour lui, appuyée contre une stèle, un bouquet
d’iris mauves et jaunes pour rehausser la pâleur
de son teint ; elle n’avait pas la blondeur légendaire
des Vénitiennes. Un gros chat noir couché à
ses pieds scrutait le spectateur. Un grand moment d’émotion.
Le jour suivant, il trouva la force de plonger ses pinceaux
dans une huile de sa composition pour qu’ils ne se dessèchent
pas ; un geste symbolique car des voiles crépusculaires
alourdissaient déjà sa vue comme le tomber de
rideau de l’acte final de sa vie. Ce fut la dernière
fois que mains et pinceaux convolèrent en justes noces.
« Lorsque larmes et rires s’unissent, tout finit
par disparaître. » dit un vieux proverbe…
|
|
Ce
livre est édité par  - Alain Daumont
- Alain Daumont
206 pages — Format : 15 x 23 cm

|
En
vente sur Internet -
Paiement sécurisé avec PayPal |
| |
|



00036131 |
Optimisé
en 1024 x 768
Site
réalisé par Dominique
- Tous droits reservés pour tous les pays. |
|
|