| |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
Entracte
: |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |



|
|
Un
journaliste a écrit : « Qui n’a pas rêvé
de la Californie ? » Moi… répondrai-je.
L’Amérique qui dépasse ses limites c’est
aussi celle qui oublie les autres, qui se crée un monde
à part bien protégé de la misère,
la rendant transparente ! C’est peut-être pour
cela qu’il ne nous reste que des vestiges de l’Ouest.
Mais nous avons appris à faire avec. Je ne rêve
pas de leurs entrepôts de King’s Saddlery à
Sheridan dans le Wyoming, je ne rêve pas de m’acheter
la panoplie du parfait cow-boy pour fin de semaine à
la campagne… Les maisons de style Victorien, les «
Painted Ladies », ne me font pas remonter à l’époque
de la ruée vers l’or !
Je préfère de beaucoup regarder « Sept
hommes à abattre » de Bud Boetticher, de 1957,
avec Randolph Scott, Lee Marvin et Stuart Whitman. Un shérif
qui part à la recherche de sept bandits… ça
me va très bien !
J’ai même un faible pour « Les rôdeurs
de la plaine » de Don Siegel, de 1960, avec la naïveté,
en bonus, en la personne d’Elvis Presley ! Fils d’un
fermier et d’une Indienne, Dolorès del Rio, il
se trouve au centre du conflit qui oppose les blancs aux Indiens
Kiowa. Bigre… un western sur la fraternité !
Il ne risquait pas d’être au box-office.
Pas plus que « La Furie du Texas » de Edwin L.
Marin, de 1951, (titre original : Fort Worth), avec Helena
Carter et Randolph Scott qui, heureusement, est là
pour remettre de l’ordre à Fort Worth. Malheur
à celui qui revient, il retrouvera une ville terrorisée.
L’un des plus beaux westerns qu’il me fut donné
de voir est incontestablement « Fureur Apache »
de Robert Aldrich avec Burt Lancaster et Joaquim Martinez
(titre original : Ulzana's raid). Ici, l’Apache qui
ose sortir de sa réserve fournira à l’homme
blanc qui l’a si souvent caricaturé, toutes les
excuses.
Piper Laurie, une actrice que j’ai toujours beaucoup
aimé et que l’on retrouvera plus tard dans «
Les Enfants du Silence » était au générique
de « Le Fleuve de la Dernière chance »
de Jerry Hopper, de 1955, avec également Dana Andrews
et Rex Reason. Le nec plus ultra des westerns… ce que
l’on aurait aimé voir plus souvent ! Un ancien
officier réussit à rétablir la paix entre
blancs et apaches !
Pour ceux qui aiment le genre pastiche avec femme-bandit,
ne pas oublier « Le Fils du visage pâle »,
une comédie de Frank Tashlin avec Bob Hope, Jane Russel
et Roy Rogers.
D’un coin bien caché à l’abri des
regards, j’exhume « Femme et Démon »
de George Marshall, de 1939, d’après le roman
de Max Brand avec Marlène Dietrich, James Stewart,
Charles Winninger. Une histoire de gang et de saloon où
règne la maîtresse du chef de la bande. Pour
la petite histoire, Marshall signera même son propre
remake en 1954 intitulée cette fois « Le Nettoyeur
» mais il y manquera le charme des acteurs de la précédente
version.
Mon coup de cœur de ce soir ira à « Les
Dynamiteros » de Burt Kennedy, de 1971, avec Richard
Crenna, John Huston et Chuck Connors (titre original : La
spina dorsale del diavolo). Un camp d’entraînement
de commandos qui nous ferait presque songer aux futures guerres
modernes, dirigé par Caleb, un déserteur, seul
capable d’affronter un chef Apache.
Mais comme je ne suis pas avare de mon temps, et pour passer
une bonne nuit, retrouvons « Du sang dans le désert
» d’Anthony Mann, de 1957 (titre original : The
tin star). Qui pourrait se vanter d’avoir oublié
Henri Fonda ? Toujours tiré à quatre épingles,
que ce soit dans « L’Homme aux colts d’or
» ou dans « Il était une fois dans l’Ouest
» où il n’hésite pas à casser
son image en tenant le rôle du méchant.
Et sur une musique d’Ennio Moricone… je vous dis
« Bonsoir ! »
|
|

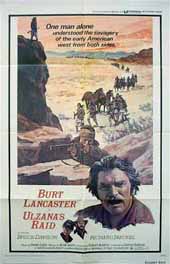

|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |




|
|
Dans
mon voyage à travers les films que j’ai aimés,
il y a ceux qui laissent une sensation particulière,
parfois un malaise. On peut y penser plusieurs jours. Ils délogent
probablement des éléments consignés dans
la mémoire universelle… tout comme l’inspiration
en peinture en est certainement l’évanescence.
Il en est de même pour l’écriture ; pourquoi
ressent-on en pleine nuit le besoin de se mettre à sa
table de travail ? Nous sommes des pantins manipulés
et la bonne question serait de se demander : « Par qui
? »
Ce soir, le ciel est plus clair que d’habitude. Sous la
lumière diaphane d’un réverbère,
je viens avec mes films !
« À bout portant » de Don Siegel, de 1964,
avec Lee Marvin et Angie Dickinson, un polar noir d’une
telle efficacité, d’une telle violence qu’il
ne fut pas distribué en salle à sa sortie. C’est
le remake en couleur du film de Robert Siodmak « Les Tueurs
» de 1946, avec Ava Gardner et Burt Lancaster. Ce fut
aussi, pour la petite histoire, la dernière apparition
de Ronald Reagan au cinéma. Il préféra
ensuite la politique !
Pour continuer sur cette lancée, un personnage que j’aime
beaucoup, c’est « Abraham Lincoln ». Le film
que fit David Wark Griffith sur ce personnage en 1930 est inoubliable
: le destin tragique de celui qui sera assassiné en 1865,
avec Walter Huston dans le rôle titre, Una Merkel et Kay
Hammond. Je déteste la violence, elle fait peur à
tout être normalement constitué ! Elle pulvérise
ce qu’il y a de bien chez l’homme.
On sera servi avec la guerre des gangs de 1929 racontée
par Roger Corman en 1967 dans « L’affaire Al Capone
» avec Jason Robards. Il serait de mauvais goût
de s’écrier : Bonne Saint-Valentin ! Lorsque
l’on regarde l’Amérique d’aujourd’hui,
on n’a même plus l’impression qu’il
s’agit du même continent.
En France, les fameux crimes de Lurs alimentèrent l’actualité
des années cinquante. Claude Bernard-Aubert donna une
version cinématographique de « L’affaire
Dominici » en 1973 avec Jean Gabin, alias Gaston Dominici,
un rôle aussi fort que dans « La Horse ».
Ce qui hier était impressionnant l’est toujours
aujourd’hui : nous ne saurons jamais la vérité.
Elle est dans un coin de l’univers, bien à l’abri
de la justice qui ne sut jamais trouver de preuves, encore moins
de mobile. Victor Lanoux, Daniel Ivernel et Gérard Depardieu
étaient également au générique.
Faisons une pause et rêvons sur « L’Aigle
à deux Têtes » de 1948. L’impossible
amour d’une reine solitaire et d’un jeune anarchiste
sosie du roi défunt. On ne ressort jamais indemne d’un
film de Cocteau ! Il vous creuse jusqu’au cœur, pour
ceux qui en possèdent un… Il est parfois notre
part d’ombre. Dans le rôle principal, son acteur
fétiche Jean Marais, sans oublier Edwige Feuillère
et Silvia Monfort.
Dans un tout autre registre, « À la recherche de
M. Goodbar » de Richard Brooks, de 1977, me fit une grosse
impression. Les deux faces d’une femme, Thérésa,
catholique parfaite le jour et, vamp la nuit, qui erre en besogneuse
dans les bars, à la recherche des hommes, comme le ferait
la mante religieuse ! Sexualité détraquée
jusqu’à l’horreur d’un assassinat sordide.
Cauchemars garantis avec Richard Gere, Alan Feistein et Diane
Keaton, l’une des égéries de Woody Allen.
Passons à un film étrange d’une grande beauté
esthétique où le drame est omniprésent
: « Alexandre Nevski », film historique de Sergueï
M. Eisenstein avec Nicolai Tcherkassov et Dimitri Orlov. Ce
film de 1938, prémonitoire, semble dire : Malheur à
qui voudra entrer en Russie par la force, il périra par
le glaive! La scène de la gigantesque bataille qui dure
40 minutes est mémorable ! L’utilisation des ombres
et des lumières très contrastées en fait
un chef d’œuvre du noir et blanc. Ceux qui, comme
moi, ont un faible pour les chevaliers teutoniques assistent
ici à une véritable fresque romantique où
les Teutons seront engloutis dans le lac Peïpous gelé
!
Il ne faut pas rester sur un gros frisson ! Ceux de ma génération
qui ont adoré Brel ne peuvent oublier le grand Jacques
dans « La bande à Bonnot » le film de Philippe
Foursastié de 1968 avec également Bruno Cremer
et Annie Girardot. À 18 ans, on est anarchiste par vocation
et Clemenceau disait : « Je me méfie des jeunes
qui n’ont pas été révolutionnaires
à 20 ans ! » La bande à Bonnot qui cherchait
à déstabiliser la société capitaliste
finira par être démantelée. En mai 1968,
le ton aura changé. Je ne garde pour le plaisir que ce
petit mot doux tiré de Marcus : « Le pouvoir est
à l’imagination ! » Au rêve aussi…
grand Dieu ! Les chevaliers Teutoniques continueront d’alimenter
mes rêves en noir et blanc mais je souhaite que les vôtres
soient en couleurs, bien sûr ! |
|




|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
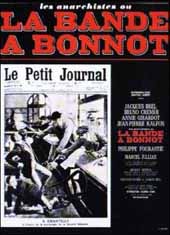 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Marlène
92 |
|
|
|
| |




|
|
Comment
ne pas parler de celle qui me fit tant rêver autrefois,
Maria Magdalena Dietrich - qui vit le jour à Berlin,
le 27 décembre 1901 - une exception, avec quelques autres
stars, pour sa longévité cinématographique.
Malgré sa grande rivale : Greta Garbo, elle fit une longue
carrière à Hollywood, et ce n’était
pas chose facile. Les studios avaient des exigences, malheur
à ceux qui, à cette époque, ne se prêtaient
pas à leurs caprices : fiançailles, mariages,
mœurs à ne pas ébruiter, tout était
arrangé ! Et pourtant, ce fut bien souvent elle qui les
fit plier…
Grande séductrice - Gabin en fit les frais -, femme lucide,
mœurs équivoques, Marlène est avant tout
un mythe. Moins estimable, sans doute, sa tendance femme
dominatrice. Ce côté fonceur viendrait-il
de sa filiation avec un officier de cavalerie ou de son enfance
à Weimar, dans un milieu protégé mais marqué
par la discipline ? Sans une maladie du poignet, elle n’aurait
peut-être été que violoniste. Curieuse destinée
que celui de cette femme prise dans le Berlin en crise des années
20, années de Bohème d’une jeunesse sans
repères, jouant du violon dans les cinémas !
C’est dans « Le petit Napoléon » de
Georg Jacoby, que son nom apparaîtra pour la première
fois, en 1923. Premier mariage aussi avec Rudolf Sieber. Ses
attitudes provocantes, souvent ambiguës, la feront remarquer.
Je pense, par exemple, à « Es Liegt in der Luft
», un spectacle musical avec la très masculine
Margo Lion.
Les films « Cafe Elektric » en 1927 et « Prizessin
Olala » en 1928 feront d’elle une vedette à
part entière. Le tournant décisif de sa carrière
viendra de sa rencontre avec Josef von Sternberg. Avec lui,
elle deviendra la célèbre Lola-Lola, du roman
de Heinrich Mann, dans « L’Ange Bleu » en
1930. L’absence d’innocence et la sensualité
du rôle la définisse tant dans ce film-culte que
dans la vie. Viennent ensuite « Cœurs brûlés
» en 1930 et « Blonde Vénus » en 1932.
Suivront, toujours sous sa direction, les superbes : «
Shanghai-Express » en 1932 et « L’Impératrice
rouge » en 1934. Dans « La femme et le Pantin »
en 1935, elle ne détruira pas moins de deux amants !
En sept ans, Sternberg accomplira un vrai miracle. Elle passera
du statut de pulpeuse et blonde allemande, un peu vulgaire,
à celui de star glamour s’exhibant dans les tenues
les plus inattendues ! Plumes, peau de gorille, mais surtout,
smokings d’homme ! Leur union, amour et perversité,
ne durera que cinq ans...
D’autres grands réalisateurs feront pour elle des
films sur mesure : Frank Borzage avec « Désir »
en 1936, Lubitsh avec « Ange » en 1937, Billy Wilder
avec « La scandaleuse de Berlin » en 1948. Même
Alfred Hitchcock succombera avec « Le grand Alibi »
en 1950. Orson Welles rendra hommage à Streinberg en
lui confiant un rôle bref dans « La Soif du mal
» en 1958. Intraitable en matière d’éclairage,
elle exigera pendant toute sa carrière les meilleurs
professionnels.
Je ne parlerai pas des films qui suivront. Marlène y
perd de son originalité, devient plus terrestre. Son
dernier rôle d’importance sera dans « Le Jugement
de Nuremberg » de Stanley Kramer, en 1961.
J’aime cette femme de conviction qui, dès 1937,
refusera de retourner en Allemagne, malgré le pont d’or
que lui faisait Goebbels, et prendra la nationalité américaine.
Chapeau Madame Dietrich, même si vous n’aviez pas
besoin, pour asseoir vos idées, de vos tournées
de propagande parmi les G.I. entre 1943 et 1945 ! Le pardon
des Allemands viendra assez tard, vers 1960.
En 1953, elle avait repris sa carrière de chanteuse ;
elle fera une tournée en Europe et, pour la première
fois depuis la guerre, retournera à Berlin mais ce n’est
qu’en 2002 qu’elle sera nommée citoyenne
d’honneur de cette ville. Notre plaisir, à nous
français, sera de l’avoir gardé jusqu’à
la fin de sa vie à Paris, rue Montaigne, où elle
s’éteindra en 1992. Il est stupéfiant de
constater qu’elle était passé du personnage
qu’elle s’était construit, son propre Pygmalion,
à une vie de recluse.
Je vous salue, Lola-Lola… enfin, je veux dire Marlène…
Vous avez été notre Ange Bleu ! |
|




|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |


|
|
Pour
moi, le cinéma de toujours c’est sur grand écran,
le cinéma en salle. Bien sûr, je suis un nostalgique
du Rex à Paris, de l’ancienne époque, avec
une seule salle… mais quelle salle ! Très prisée
des étrangers. L’été, les Américains
y débarquaient chapeau texan enfoncé sur la tête
et pour les fêtes de fin d’année, on voyait
plutôt les nordiques. Le spectacle sur scène était
unique en Europe : la féerie des eaux ! Mais il y a aussi
le drive in… et dans ces circonstances, le « Napoléon
» d’Abel Gance, dans sa version originale, sept
heures de projection quand même, ferait bien l’affaire.
La défaut de la cassette, c’est le manque de précision
et la taille de l’écran alors on finit par se passer
de certains détails… au profit de la multiplication
des passages ! Mais le cinéma de papa restera toujours
mon cinoche à moi !
Aujourd’hui, le registre sera à la politique.
Tout d’abord, avec « A lion in the streets »
de 1953, de Raoul Walsh, avec James Cagney, Barbara Hale et
Jeanne Cagney, un simple homme de la rue qui deviendra un homme
politique ; comme aujourd’hui, sa candeur et sa pureté
s’effaceront au profit de son ascension vers le poste
de gouverneur.
On peut aussi revisiter « À cause d’un assassinat
» d’Alan Pakula, de 1974, avec Warren Beatty et
Paula Prentiss : un journaliste qui cherche à démonter
un complot, ça nous fait penser à l’affaire
John F. Kennedy ou aux « 3 jours du condor ».
Comme l’eau de la rivière va à la mer, l’histoire
se répète. On peut s’attarder sur «
Adalen 31 », de 1969, du Suédois Bo Widerberg,
avec Peter Schildt et Kerstin Tibelius : 1931, grèves
des dockers dans ce port suédois qui se terminera par
le massacre des ouvriers ! Pas d’hier les fronts de type
populaire !
Dans le genre tous les remakes passent par le cinéma,
je vous propose « L’adieu aux armes » de 1957,
de Charles Vidor, avec Rock Hudson, Jennifer Jones et Vittorio
de Sica. Personnellement, je préfère celui de
1932 sous le titre français « L’adieu au
drapeau » de Frank Borzage, avec Gary Cooper, Helen Hayes
et Mary Philips : un jeune soldat qui découvre le bonheur
avec une infirmière pendant la guerre. Ce n’est
pas d’hier que l’on tombe amoureux de sa soignante
!
Comme j’aime bien passer du tiède au chaud, voici
un très beau film de 1986, « L’affaire Chelsea
Deardon » d’Ivan Reitman, avec Robert Redford, Darryl
Hannah et Debra Winger. Lorsque l’on est la fille d’un
peintre renommé des années 60, faut pas piquer
les toiles de son père !
Pour ce soir, mon coup de cœur ira à « Les
Ailes du Désir » de 1987, de Wim Wenders avec Bruno
Ganz, Peter Falk et Solveig Dommartin. On ne peut faire confiance
aux anges… sauf à ceux qui sont nos gardiens !
Dans le cadre de l’austère ville de Berlin, un
ange tombe amoureux et devient mortel, quelle horreur ! Nous
perdons tous un jour nos illusions sur ce monde, les anges…ce
sont leurs ailes. Décidément, personne n’est
à l’abri des coups du destin.
Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Oh… j’oubliais…
mes ailes, je les ai toujours… mais j’hésite
à m’en servir. Peut-on faire totalement confiance
à Wenders ? |
|


|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |





|
|
Les
Enfants du Silence - 1986
Si je devais partir sur une île déserte, j’emporterais
ce qui est, à mon sens, le seul chef d’œuvre
du cinéma mondial : « Les Enfants du silence »
de Randa Haines (Children of a lesser god). Tout y est parfait,
de la mère qui essaie de comprendre sa fille et se juge
en échec, interprétée par Piper Laurie,
au personnage de Sarah, par Marlee Matlin, extraordinaire de
rébellion dans un premier temps, puis d’amour véritable,
sans fioritures ; un amour qui va à l’essence même
de l’être. Elle sera d’une exigence intraitable
car elle sait qu’elle a trouvé celui qui sera capable
de la comprendre. À ce propos, William Hurt en James
Leeds, professeur attentif qui tente d’expliquer Bach
à Sarah, comme un oiseau qui voudrait ne plus souffrir
de l’absence de ses ailes, est magique. Je puis vous l’assurer,
bien calé dans votre fauteuil, vous gagnez les octaves
supérieures de ce moment d’état de grâce
! J’aimerais avoir dans mon tombeau les meilleurs moments
de ma vie et… ce film de Randa Haines ! Les archéologues
tombant là-dessus, ne pourraient que dire : « Ça…
c’était de l’amour ! » Ce qui est de
plus en plus rare au cinéma, la musique de Michael Convertino
est une merveille d’adaptation. Ce petit bijou de film
est adapté de la pièce de Mark Medoff.
Au début du film, Sarah s’obstine à rester
dans son monde du silence. Elle repousse James Leeds qui s’acharne
à vouloir la comprendre malgré les tours qu’elle
lui mijote. Même là, les scènes sont attendrissantes
! On dirait la parade nuptiale de certains oiseaux tropicaux
qui exhibent leurs plus belles couleurs… La plus belle
scène d’amour se passe dans la piscine de l’institution
où ils vivent. L’eau leur sert de vêtement,
l’onirisme vient de l’élément liquide
qui les enveloppe, rend pudique l’union des corps. Il
est dit que les forces du yin et du yang sont interdépendantes…
peut-être… sûrement !
William Hurt/James Leeds commet tout d’abord le péché
d’orgueil en voulant atteindre Sarah dans la partie obscure
d’elle-même et, pour une fois, ce défaut
devient qualité ! J’aurais été vraiment
déçu que le film se termine mal, j’avais
d’ailleurs au fond de moi, comme un ado, un happy end
en réserve mais Piper Laurie m’épargna cela
en faisant subtilement admettre à Sarah qu’elle
ne pouvait se passer de James Leeds !
À noter que Marlee Matlin obtint l’oscar de la
meilleure actrice en 1987.
Le monde des handicapés ne me touche pas par hasard.
Pendant de nombreuses années, je leur ai consacré
beaucoup de moments de ma vie. Les voyages intérieurs
avec eux, je connais ! J’ai vu 16 fois « Les Enfants
du silence » en salle… et j’ai la cassette
! Toujours avec la larme à l’œil, et toujours
un moment hors du temps ! Quand on aime, on ne compte pas !
Je remets ce film dans son écrin, un monde sans bruit
où les mains sont les pinceaux du peintre, la glaise…
le sang du sculpteur. Je vous souhaite le meilleur : vous sentir
souvent prisonnier de vos passions ! |
|





|
|
| |


|
|
 |
|


|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Louis
Jouvet – 1887-1951
|
|
|
|
| |






|
|
Pour
ceux qui aiment le cinéma français, ne pas s’attarder
sur Louis Jouvet, personnage incontournable à l’aise
dans tous les rôles, serait un crime ! À notre
époque et dans un registre différent, je ne vois
que Gérard Depardieu capable d’interpréter
des rôles aussi disparates que « Green card »,
« Mon père, ce héros » ou «
Le Colonel Chabert ». Mais ma préférence
va à Jouvet ! Pour le prix d’un, on en a plusieurs
: homme de théâtre, de cinéma mais aussi
metteur en scène et animateur de compagnie, il fut l’un
des plus imposants personnages du 7e art du XXe siècle.
C’est sa diction unique dans le cinéma français
qui le singularisa des autres comédiens. Il en inspira
beaucoup. « Le théâtre, disait-il, ça
ne s’apprend pas, ça ne s’explique pas non
plus, ça se vit ! » Paroles prophétiques
dans un monde où les effets spéciaux ont remplacé
l’intelligence et la culture. On aurait pu graver cela
sur sa tombe ! Jouvet veilla sur ceux qu’il aimait et
estimait à la manière d’un mécène
et sans lui, de nombreux artistes seraient restés dans
l’ombre. Aujourd’hui, les grands mécènes
ont disparu. Eddy Barclays fut sans doute le dernier. Appréciez
la nuance : chez lui, œuvraient des directeurs artistiques…
maintenant, ce sont des chefs de produit !
Pour notre plus grand plaisir, Jouvet vivra très tôt
sa passion. Diplômé de pharmacie – tous les
chemins mènent à Rome – il quittera sa Bretagne
natale pour Paris, en 1907, pour interpréter dans une
société d’amateurs, le « Groupe d’Action
d’Art », quelques textes sans véritable importance.
Sa rencontre avec Jacques Copeau qui l’engagera comme
régisseur et comédien au théâtre
du vieux Colombier, en 1913, sera déterminante pour sa
carrière. Dix ans plus tard, Jouvet signera déjà
sa première mise en scène, « Knock »
de Jules Romains, à la Comédie des Champs-Elysées
; il n’a que trente-six ans. La célèbre
tirade : « Est-ce que ça vous gratouille ou est-ce
que ça vous chatouille ? » le suivra pendant vingt-sept
ans ! L’éclairage de l’homme est à
sa pleine puissance lorsqu’en 1927, il rencontre Giraudoux.
Il montera « Siegfried » en 1928. L’univers
du poète lui colle à la peau. Comme une mèche
très tôt allumée, suivront « Tessa
», « Electre », « La guerre de Troie
n’aura pas lieu », « Amphitryon 38 »,
« Ondine », « Intermezzo », «
Sodome et Gomorrhe », « L’Apollon de Bellac
» et « La Folle de Chaillot ». Époustouflant
! Que des chefs d’œuvres ! Là, il faut reprendre
son souffle. Les mises en scène, les interprétations
de Jouvet et de sa compagnie, (constituée en 1924) deviendront
des chefs d’œuvre du théâtre français.
Mais ce n’est pas fini. Sur la scène de l’Athénée,
Jouvet rajoutera un grand nom : Marcel Achard. Et ça
recommence avec « Jean de la lune », « Domino
». Moins connu du public, « Léopold le bien-aimé
» de Jean Sarment. Puis ce sera Corneille avec «
L’illusion comique », Molière avec «
L’école des femmes » (une perle !), «
Tartuffe » et « Don Juan ». Même Jean
Genet y passera avec « Les bonnes » et un autre
– non des moindres – Jean Paul Sartre qui lui proposera
la mise en scène de sa pièce « Le Diable
et le bon Dieu ».
Auteur et metteur en scène prolifique, cela ne l’empêchera
pas d’assurer ses cours au conservatoire dès 1934.
À deux reprises, il refusera le poste d’administrateur
de la Comédie Française. On peut penser qu’il
craignait de ne pas avoir les mains libres. Nous tenons de lui
sa vision du théâtre, elle est fort simple : «
Mettre en scène, c’est servir l’auteur, l’assister
par une totale dévotion qui fait aimer son œuvre
sans réserve ! » Que c’est beau et bien dit
! Il faut préciser que l’attitude de Jouvet face
à l’œuvre jouée fera de lui l’un
des grands maîtres de son temps. Beaucoup de courants
se réclameront de lui. Même l’Actor’s
Studio, en son fondateur Lee Strasberg, verra en lui le génie
français. Jouvet sera également conférencier,
essayiste « Le Comédien désincarné
» dont le sous-titre est : Documents cliniques d'un esprit
anxieux chez un homme pour qui l'amour du théâtre
est inséparable d'un sentiment de fraternité.
Que dire de plus ? Louis Jouvet ne viendra que tardivement au
cinéma. Sa vraie carrière cinématographique
débute en 1932 par un chef d’œuvre, «
Topaze », de Louis Gasner d’après Marcel
Pagnol. À noter qu’il figurait, en 1913, au générique
du court métrage muet d’Henri Desfontaines, «
Shylock ». On ne saura jamais pourquoi il entretiendra,
comme il le disait, des rapports équivoques avec le cinéma
allant jusqu’au malaise. Et il passera vingt-neuf ans
dans ces rapports-là ! Belle performance… Par cette
phrase plus que claire « Le cinéma est seulement
un mode d’expression dramatique ou l’acteur peut
utiliser ses talents mais non pas les découvrir ou les
nourrir », on sait qu’il opposait le théâtre
au cinéma. Il fut le penseur du cinéma français,
celui qui y aura réfléchi le plus.
Deux films seulement auront son agrément sur les quarante
dans lesquels il eut un rôle : « Topaze »
et « Knock ». D’autres pourtant ne furent
pas négligeables. Que ce soit « Du haut en bas
» en 1933, « La kermesse héroïque »
de Jacques Feder, en 1935, puis son rôle le plus poignant
dans « Les Bas-Fonds » de Jean Renoir en 1936 où
il campe un baron inoubliable. Ensuite « Mademoiselle
Docteur » en 1937, « Le Drame de Shanghai »
en 1938, « L’alibi » en 1937 de Pierre Chenal,
« La Maison du Maltais » en 1939 ! Un autre grand
interviendra dans sa vie, Julien Duvivier, avec « Un carnet
de bal » en 1937, « La Fin du jour » et «
La charrette fantôme » en 1939. Mon préféré
reste « Drôle de drame » de Marcel Carné,
de 1937. Sa popularité atteindra son apogée avec
le tandem qu’il forma avec Arletty dans « Hôtel
du Nord » en 1938, du même réalisateur. Par
la suite, les gens iront voir les films avec Jouvet, uniquement
pour Jouvet, pour son jeu, sa voix…
En juin 40, l'armistice est signé et on lui suggère
de monter Heinrich von Kleist plutôt que Giraudoux et
Romains. Fidèle en tout, il partira en mai 1941 pour
une tournée de six mois en Amérique du Sud qu’il
prolongera quatre ans, jusqu’au 12 février 1945,
date de son débarquement à Marseille. À
son retour, il retrouvera les studios avec « Un revenant
» en 1946 de Christian Jacque – à voir et
à revoir ! – puis une seconde version de «
Knock » en 1951 dont il supervisera la réalisation.
Il est curieux de constater que les films qui laisseront une
trace dans la mémoire du public seront ses derniers films
: « Quai des orfèvres » de 1947, de H.G.Clouzot,
et « Lady Paname » de 1949. Les plus beaux dialogues
dits par Jouvet auront été ceux d’Henri
Jeanson. Pour un acteur qui débuta au cinéma à
l’âge de quarante-six ans, compliments… Monsieur
Louis Jouvet ! |
|





|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
suite…
|
|
|
|
|