| |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
Entracte
: |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |




|
|
Dans
les films marquants qui méritent plusieurs détours,
mon préféré est sûrement «
La Nuit du Chasseur » (The Night of the Hunter) de Charles
Laughton, de 1955, avec Robert Mitchum et Shelley Winter, d’après
le roman de David Grubb. C’est l’un des films les
plus étranges du cinéma américain. Œuvre
unique de l’acteur Charles Laughton, ce film, sorte de
policier à contre-courant, échappe aux canons
du récit hollywoodien de l’époque et ne
se plie à aucun genre particulier. Il est de la trempe
des films de Griffith. Un vrai film-culte pour ciné-club.
Vous aurez compris qu’à sa sortie en salle il n’eut
qu’un tout petit succès ! Harry Powell (Robert
Mitchum) est un criminel psychopathe qui partage sa cellule
avec Ben Harper (Peter Graves), un condamné pour vol
et meurtre qui sera pendu sans avoir révélé
la cachette de son butin. Seuls les enfants de Ben Harper, John
(Billy Chapin) et sa sœur Pearl (Sally Jane Bruce) savent
que les dix mille dollars sont cachés dans la poupée
de la fillette. Alors commence la traque d’Harry Powell/Robert
Mitchum que son jeu subtil rend magnifique dans un rôle
de prédicateur des plus crédibles. Un beau rôle
de prédateur ! La police finira par arrêter Harry
et les enfants seront délivrés de leur secret.
Un film français également décalé
qui mérite un détour : « Le Vieux Fusil
» de Robert Enrico, de 1975 – trois César
la même année et le César des César
en 1985 – avec Philippe Noiret, Romy Schneider et Jean
Bouise (comédien discret, superbe d’efficacité
au cinéma). L’action se passe à Montauban
en 1944, presque un huis clos dans le château familial
du chirurgien Julien Dandieu (Philippe Noiret). La première
scène côtoie l’horreur, le film s’inspire
du massacre d’Oradour sur Glane, je la passe volontairement
sous silence. Grâce au chirurgien Dandieu, la traque peut
commencer. Vengeance expiatoire d’un homme ivre de douleur
avec, pour seul compagnon, un fusil à chevrotines et,
en toile de fond, un château avec des pièges redoutables.
Une véritable forteresse médiévale surplombant
une vallée !
Mais changeons de sujet avec Hitchcock. Personnellement, ma
notation se module selon les films mais certains sont de véritables
chefs d’œuvres. Dans la période anglaise,
« Les 39 Marches » de 1935, avec Robert Donat, Madeleine
Carrol, Lucie Marinheim, d’après le roman de John
Buchan est l’un d’eux. Richard Hannay (Robert Donat)
héberge une jeune femme dans son appartement londonien,
ignorant, bien entendu, qu’elle est agent secret et en
lutte contre une mystérieuse organisation. Elle sera
assassinée dans la nuit et aura juste le temps de lui
révéler le nom du village écossais où
siège ladite organisation ! Traques à répétitions
et angoisse garanties !
Toujours dans le registre de l’étrange : «
Les 4 Cavaliers de l’Apocalypse » de Vincente Minnelli,
de 1961, avec Glenn Ford, Charles Boyer, Ingrid Thulin et Lee.
J. Cobb. En Argentine, en 1938, l’histoire d’une
famille déracinée après la mort du vieux
Madariaga (Lee. J. Cobb). Ils se retrouvent à Paris sous
l’occupation, troquant une Argentine en mutation pour
une France en désordre. Il y en a qui ont vraiment la
poisse ! Lutte à l’intérieur et à
l’extérieur : les personnages s’entre-dévorent
pendant que la France est occupée par les nazis. On n’est
pas sans penser à Scola ou Pasolini !
Je terminerai par « Key Largo » de John Huston,
de 1948, avec Humphrey Bogart, Edward G. Robinson et Lauren
Bacall, un huis clos l’ambiance sulfureuse où les
personnages s’épient et se guettent pour voir qui
fera le premier faux pas. Le film est tiré de la pièce
de Maxwell Anderson. Frank McCloud (Humphrey Bogart), héros
de la seconde guerre mondiale, un peu mégalomane, rend
visite à la veuve d’un de ses compagnons d’armes,
Nora (Lauren Bacall). Elle tient avec son père un hôtel
perdu sur l’île de Key Largo, en Floride. Ce sera
le siège de l’épais malaise qui imbibe tout
le film, le rendant par moments statique. Rien de particulier
jusqu’à l’arrivée du gangster Johnny
Rocco (Edward. G. Robinson) et également d’un ouragan
qui va isoler l’île pour plusieurs heures. Le pourrissement
de la situation ira crescendo. On attendait beaucoup de Bogart
et le décalage vient de là, il restera étrangement
indifférent. Une attitude identique à celle qu’auront,
au retour du Vietnam, quelques années plus tard, les
vétérans qui ne trouvaient plus leur place.
Alors pour ne pas nous endormir là-dessus, je vous conseillerai
un film de 1987, totalement déglingué : «
Who’s that Girl ? » , une comédie de James
Foley avec Madona, Griffin Dunne et Haviland Morris. Le titre
du film est celui de la chanson de Madonna, elle incarne un
personnage excentrique (on avait l’habitude !). Si ça
ne vous fait pas de bien, ça ne vous fera pas de mal
! Sur ce… je vous souhaite une bonne nuit ! |
|




|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |





|
|
La
Grande illusion - 1937
Souvent
les films de guerre sont d’une pauvreté étonnante.
Peut-être parce que les armes remplacent le scénario.
Il n’en est rien avec « La grande Illusion »
de Charles Spaak et Jean Renoir et sa troïka de grands
acteurs : Pierre Fresnay (le capitaine de Boëldieu), Jean
Gabin (le lieutenant Maréchal) et Eric von Stroheim (le
capitaine von Rauffenstein). Outre ces grandes pointures, il
ne faut pas oublier Marcel Dalio (Rosenthal), Julien Carette
(l’acteur), Dita Parlo (Elsa), Jean Dastré (l’instituteur),
Georges Reclet (un officier) et Jacques Becker (un soldat anglais).
Ce film obtiendra le prix du jury international du meilleur
film artistique à Venise ainsi que le prix du meilleur
film étranger décerné par la critique américaine
! Lorsque l’on songe au blocus que les Américains
font aux films qui ne sortent pas de leurs studios, celui-là
doit vraiment être un chef d’œuvre !
L’argument : pendant la première guerre mondiale,
dans un camp de prisonniers à la frontière franco-allemande,
une tentative de rapprochement entre des hommes ennemis de circonstance.
Dans le camp, la vie s’organise tant bien que mal et ces
hommes de toutes origines vont former un bloc de résistance
avec en parallèle la confrontation de deux officiers
ennemis, aristocrates, et nostalgiques d’une époque
épique qui n’est assurément plus la leur.
Deux prisonniers français s’évaderont et
gagneront la Suisse grâce à l’aide d’une
paysanne amoureuse de l’un d’eux. Le rapport entre
les deux officiers rend le film marginal. Lentement, ils vont
apprendre à s’apprécier mais surtout à
se respecter, évoquant le déclin de leurs aristocraties
respectives et… l’absence de respect de cette époque
pour les hommes de guerre ! Mais existe-t-il un intérêt
à la guerre ? C’est un huis clos étouffant
avec des dialogues d’une rare beauté et également,
d’une rare efficacité ! C’est presque du
théâtre. Une grande réussite.
En 1937, le film sera amputé de dix-huit minutes par
la censure qui y voyait une entreprise de démoralisation
! Les choses iront plus loin car à l’aube de la
seconde guerre mondiale, cette œuvre idéaliste,
quelque peu pacifiste, sera perçue comme une mise en
garde qui ne sera d’ailleurs pas comprise puisque celle
de 39 avait encore de beaux jours devant elle. Jean Renoir donnera
tout son talent à la magistrale étude de caractère
de ses personnages. Le stalag est un révélateur
de l’âme humaine. L’étude des différentes
couches sociales est suractivée par le confinement et
l’insupportable promiscuité. Jean Gabin, égal
à lui-même, nous donne un moment fort comme dans
« Pépé le Moko » ; Maréchal
correspond au français moyen de l’époque,
pétri de bon sens, grande gueule au patriotisme indéfectible,
et Rosenthal donne une version idéaliste de l’assimilation
réussie de la communauté juive au sein de la société
française. L’histoire, malheureusement démontrera
le contraire, le IIIe Reich nazi professait un antisémitisme
endémique et barbare. Le personnage le plus touchant
est sans doute Boëldieu, imprégné de romantisme,
lucide, conscient que son aristocratie est déliquescente,
qui ne peut se reconnaître dans un monde où l’honneur
est tombé en désuétude.
Dans l’œuvre de Renoir, qui ne se pose jamais en
donneur de leçons, ce film est à part. Son truc
à lui, c’est plutôt un savant jeu de massacre
dont personne ne sort indemne, comme dans « La règle
du jeu ».
En 1958, « La grande Illusion » sera classée
parmi les douze meilleurs films au monde. Le titre résume
parfaitement le film : l’homme qui pense, l’homme
qui interroge et s’interroge, l’homme d’honneur
; tous ces types d’homme sont autant de Sésame,
ouvre-toi. Pas étonnant que la censure ait sévi
…
Je vous quitte, ce soir, avec en filigrane, la silhouette d’Eric
von Stroheim et sa minerve. Quel sacré bonhomme !
|
|





|
|
| |
 |
 |
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
James
Cagney 1899 - 1986 |
|
|
|
| |




|
|
J’ai
toujours aimé le cinéma noir américain.
Que ce soit celui d’avant ou d’après la seconde
guerre mondiale. Ainsi que les acteurs de cette époque,
comme James Cagney. Cagney est une légende, sa filmographie
est impressionnante d’autant qu’un quart de ses
rôles vont aux films de gangsters. Il débute avec
le sonore et sans sa voix, on perdrait tout le charme de son
débit haché, un staccato qui s’essouffle
par moments. On peut dire que sa vitalité lui aura permis
de nager dans les eaux salines des requins du cinéma
!
Il est né à New York en 1899 dans un milieu modeste
imprégné de tradition irlandaise et entre dans
la vie active dès l’âge de 14 ans ; on ne
compte plus ses petits boulots. Il aborde le spectacle comme
décorateur de théâtre et monte pour la première
fois sur une scène en 1919. Après six ans de cabaret
avec sa femme Frances, il décroche ses deux premiers
rôles marquants en 1930 avec « Outside Looking in
» et « Penny Arcade ». Là, commence
sa tumultueuse association avec la Warner Bros – à
souligner que son caractère cabochard et agressif ne
facilitait pas les choses, d’autant qu’il faisait
de sa virilité une profession de foi.
Il incarnera toute sa vie les classes laborieuses ; né
de la dépression, il lui doit ses turbulences. Il tournera
dans des films durs dont il essaiera toute sa vie de s’affranchir.
En 1935, il rompt avec la Warner. Il signe un nouveau contrat
avec le Grand National ou il tournera dans un film critiquant
le star-system « Something to sing about ».
C’est dans « Les Anges aux figures sales »
qu’il a le rôle de gangster que je préfère,
un face à face entre deux amis dont l’un est devenu
prêtre et l’autre gangster. Puis, « À
chaque aube je meurs » défendra les vertus de la
presse des années 30. En 1942, « La Glorieuse Parade
» marque un tournant dans sa vie. Ce film, une évocation
spectaculaire d’une des figures du music-hall américain,
George M. Cohan, un rôle à sa mesure de bête
de scène, sera récompensé par un oscar.
Les choses se gâtent lorsqu’il organise sa propre
production avec son frère, ce sera un échec total.
Malgré cela, il réussit à faire passer
son message humanitaire en toute indépendance. Il sera
pendant ce cours laps de temps « Johnny le vagabond »,
clochard poète et bon samaritain dans un univers allégorique
qui le satisfait pleinement. Il pourra ainsi parler librement
des forces de la corruption et des vertus de l’Amérique.
En 1949, il retournera à la Warner pour « L’enfer
est à lui ». Ce film est le sommet des films
du genre.
Ensuite, les personnages deviennent sans vie, sans discours
sociologique, murés dans leur solitude. Cagney, jadis
démocrate, ira vers une position plus conservatrice comme
dans « Le Fauve en Liberté », l'adaptation
d’un roman d'Horace McCoy. Sa dernière apparition
« A Lion is in the streets » parle d’un leader
populiste sans grande envergure. La vitalité de Cagney
des années 30 prend une tournure amère. À
cause de son intransigeance, il perdra l’appui de sa famille
et de ses amis ; une composante que Billy Wilder utilisera en
1960 dans « Un, deux, trois »... satire
décapante !
Ensuite, il ne tournera pas pendant 20 ans. Il manquait un dernier
tour de piste dans sa carrière, ce sera malheureusementpour
pour interpréter un préfet de police sans grand
intérêt dans « Ragtime ».
On pourrait résumer la vie de James Cagney par le titre
d’un de ses films : « À deux pas de
l’enfer ». Il n’en reste pas moins un
personnage attachant du cinéma américain. Il me
fait penser à Arthur Rimbaud : Je voulais être
un homme ordinaire ! mais toute sa vie, il serra les poings
comme dans ses films.
Il décédera à Stanfordville en 1986.
|
|

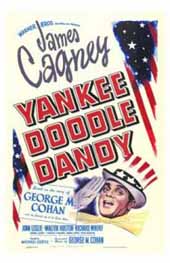

|
|
| |
 |
|
 |
 |
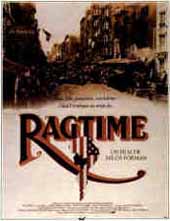 |
|
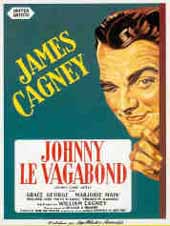 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |





|
|
L’Atalante
– 1934
Dans
le cinéma français, s’il est un film à
part – peut-être parce qu’il est imbibé
d’un romantisme au quotidien – c’est bien
cette comédie dramatique de Jean Vigo. On y retrouve
dans les rôles principaux : Michel Simon (le père
Jules), Jean Dasté (Jean), Dita Parlo (Juliette), Gilles
Margautis (le camelot), Louis Lefebvre (le mousse). La version
intégrale de ce film que l’on peut définir
de campagnard fut coupée à sa sortie
car le sujet déplaisait à la censure. Ce n’est
que beaucoup plus tard qu’il fut reconstitué.
L’argument : À peine la cérémonie
de leur mariage terminée, Jean et Juliette, un marinier
et une fille de paysans, embarque à bord de l’Atalante,
une péniche comme il en existait beaucoup à une
époque où le fret – sable et matériaux
de construction – était acheminée en grande
partie par les canaux. L’équipage est réduit
à un vieux loup de mer qui connaît tous les océans
et à un mousse.
Un récit aux antipodes de « Le drapeau noir flotte
sur la marmite », avec Jean Gabin, un marin qui n’a
jamais navigué que dans sa tête. Il n’y a
sur l’Atalante que trois protagonistes : le père
Jules, le moussaillon et la jeune épousée qui
rêve de Paris, la ville magique. La belle ne se fera pas
à la monotonie de la vie à bord et elle s’enfuira
en laissant un mari déconcerté, inattentif à
son travail et risquant de se faire renvoyer ; le spectre du
chômage ne date pas d’hier. Le père Jules
qui n’a pas l’intention de laisser cette situation
se dégrader part rechercher la « patronne »
– comme il sait si bien le dire. Il la retrouve en train
d’écouter la chanson des mariniers et la ramène
à bord et l’Atalante qui peut ainsi continuer sa
route !
Avant « L’Atalante », trois petits films pleins
de verve avaient fait connaître Jean Vigo : « À
propos de Nice », « Taris »
et « Zéro de conduite ». Ce dernier
est une évocation de la routine d’un lycée-caserne,
parsemée de notes autobiographiques, qui avait été
interdit par la censure. À noter que Vigo était
le fils de l'anarchiste Eugène-Bonaventure de Vigo, plus
connu sous le nom de Miguel de Almereyda et on pourra comprendre
que cette filiation marqua sa scolarité de conséquences.
Malgré cela, le producteur acceptera « L’Atalante »
et l’unique long métrage de Vigo verra le jour.
Le personnage du père Jules est de la trempe des personnages
de Céline ou de Cendrars. L’exactitude des scènes
du quotidien – la guinguette, le vol du sac à main
– en font une prouesse d’équilibre entre
le drame visuel et le rire. Malgré la rudesse de la vie
des mariniers que Vigo nous décrit, le film reste féerique
! Elie Faure dira de ce film à sa sortie qu’il
était tourmenté, fiévreux, regorgeant
d’idées et de fantaisie truculente, d’un
romantisme virulent bien que constamment humain. Pour l’anecdote,
c’était l’un des films préférés
de François Truffaut.
Homme à la santé délicate, au lyrisme d’un
écorché vif, Vigo mourut à l’âge
de 29 ans d’une septicémie et son destin me fait
également penser à celui de Rimbaud, une œuvre
achevée avant l’heure. Qui peut dire combien de
chefs-d'œuvre il aurait réalisé si la faucheuse
n’avait pas frappé ! Vigo ne mourut pas au champ
d’honneur mais quelques jours avant la sortie de « L’Atalante »,
à temps, oserait-on dire, car le film sortit coupé,
avec pour fond sonore une mélodie misérabiliste
chantée par Lys Gauty : « Le chaland qui passe ».
Il faudra attendre 1950 pour que ce bijou du cinéma français
soit rendu à sa splendeur originelle.
Même s’il se dégage une grande tristesse
de la vie de Jean Vigo, j’aime ces maîtres qui ne
se sont pas attardés, laissant une trace puissante et
revigorante.
|
|




|
|
| |
 |
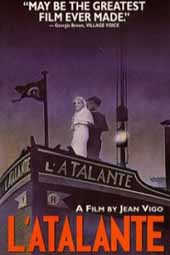 |
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |





|
|
Si
je devais écrire ma biographie, je la commencerais ainsi
: « Je suis né au milieu des chiffons et des
femmes. » Ma mère était couturière,
une grande couturière. Mon enfance baigna dans le lin,
la soie, la moire, l’astrakan, le vison et tant d’autres
belles choses. Peut-être est-ce pour cela que mon rapport
aux femmes est à l’opposé de celui d’un
Guitry ou d’un Montherlant ! À cette époque,
il n’y avait pas de jeunes filles en fleurs… juste
des arpettes et des femmes d’âge mûr. Alors,
pas étonnant que j’aime les films en costumes !
On festoie en ce mois de mai 1485, dans le premier de ceux que
j’évoquerai ici, au château du baron Hugues
qui marie sa fille Anne au chevalier Renaud. Mais cela est trop
harmonieux pour le diable... qui n’aime pas voir les gens
heureux. Alors, comme on s’ennuie ferme en enfer, il envoie
Gilles et Dominique pour séduire les mariés, et
semer le chaos sur terre. Mais il n’a pas prévu,
le Diable, que ses créatures tomberaient amoureuses de
leurs victimes. Que lui reste-t-il à faire ? Quitter
l’enfer pour venir remettre de l’ordre lui-même
sur terre !
Pas étonnant que le scénario soit de Prévert,
sa poésie transpire à travers les personnages.
L’amour doit régner et vaincre alors, pour permettre
aux héros de se retrouver, le temps suspend son vol et
le bal se fige. Une scène splendide, sûrement la
plus belle. Vous aurez reconnu « Les visiteurs du
soir » de Marcel Carné, tourné en pleine
guerre, en 1942, avec Arletty, Alain Cuny, Marie Déa,
Marcel Herrand, Fernand Ledoux dans le rôle du baron Hugues
et Jules Berry dans celui du diable. Arletty et Cuny nous offrent
un superbe moment de cinéma. Pour la petite histoire,
Cuny qui sera toujours un marginal ne s’en cachera jamais
dans ses interviews. Les lignes des costumes sont simples et
épurées mais costumes ou pas, ce film mérite
un détour !
Je me dois de citer la comédie musicale « La
veuve joyeuse » de Curtis Bernhardt, de 1952, mais
exclusivement pour Lana Turner car de toutes les versions de
cette opérette qui ont été mises en scène
pour le cinéma, ma préférence va à
cellede 1934, de Lubitsch (qui elle, est en noir et blanc) avec
Maurice Chevalier et Jeanne MacDonald dans le rôle de
la veuve joyeuse.
Dans la version de 52, Lana Turner joue le rôle de cette
veuve qui décide d’aller mener grande vie à
Paris, se faisant passer pour une entraîneuse, chez Maxim’s.
Elle sera remise dans le droit chemin par Fernandos Lamas, lui-même
pris au piège de sa propre machination. Dommage que dans
cette version la partition musicale de Franz Lehár ait
été réduite à une vingtaine de minutes
! Il n’en reste pas moins que les costumes sont à
la hauteur des attentes d’un tel cadre.
Parmi les metteurs en scène qui font de l’esthétisme
une priorité, James Ivory figure dans les premiers. Je
pense à « Chambre avec vue » de
1985, avec Daniel Day Lewis, Helena Bonham Carter, Julian Sands
et Maggie Smith. Quiproquos et grand amour naissent d’un
échange de chambre… le tout sur fond social et
avec vue sur l’Arno. Un voyage en Italie qu’une
jeune Anglaise victorienne n’est pas près d’oublier.
Des « Vestiges du jour » à « Jefferson
à Paris », dans les films de James Ivory,
décors et costumes touchent à la perfection. On
ne pourrait lui reprocher que des descriptions de vie un peu
statiques !
L’époque romaine et ses péplums affichent
des couleurs brutales avec ses costumes ! Je pense à
« La Tunique » de 1953, d’Henry
Koster, avec Richard Burton (Marcellus), Jean Simmons (Diana),
Victor Mature (Démétrius) et Jay Robinson (Caligula).
Parce que le jeune tribun romain Marcellus se voit dans l’obligation
d’assister à l’exécution de Jésus
et qu’au cours d’une partie de dés, il gagne
la tunique que le Christ portait sur la croix, sa vie va être
bouleversée. Il se convertira au christianisme et mourra
en martyr. Un récit hautement symbolique agrémenté
des poncifs du cinéma américain. Pour la petite
histoire, ce film est le premier à avoir été
tourné en cinémascope. Quant à la vérité
historique, difficile de s’y retrouver. Le film s’inspire
de « Quo Vadis » réalisé
deux ans plus tôt. De la même époque « Les
Gladiateurs » de Delmers Daves ont le mérite
de retracer le réalisme sauvage des arènes romaines.
Toujours pour les costumes, je reverrais bien « Les
trois mousquetaires ». On n’en compte plus
les versions. Celle d’Henri Diamant-Berger, de 1932, avec
Aimé Simon, Gérard Henri Rollan, Blanche Montel
et Edith Mera durait deux heures seize et faisait l’objet
de deux séances. Fred Niblo en 1921, George Sidney en
1948, André Hunebelle en 1953, Richard Lester en 1973,
Stephen Herek en 1993, ont chacun tourné la leur mais
ma préférée reste celle de 1961, de Bernard
Borderie, sans doute à cause de Mylène Demongeot...
S’il est un film, en cuirasse pour tout vêtement,
qui laisse un malaise profond, c’est bien « Aguirre,
la colère de Dieu » de Werner Herzog, de 1972,
avec Klaus Kinski, comédien exceptionnel mais, du point
de vue de ceux qui l’ont fréquenté, aussi
désagréable dans son rôle que dans la vie,
célèbre pour ses colères et ses coups de
gueule. Le film se résume par ces simples mots :
de l’homme à la folie ! Werner Herzog est
le cinéaste du romantisme allemand renouvelé et,
quand on sait que ce metteur en scène prend quatre-vingt-dix
pour cent de risques sur les tournages, on peut aisément
imaginer que le tandem Herzog/Kinski n’a pas du manquer
de piquant !
Je ne peux pas finir sur des costumes entachés de sang
et de boue, je vais donc me tourner vers le film fleur bleue
par excellence qui ne peut faire de mal à personne. « Sissi
» de 1955 d’Ernst Marischka, avec Romy Schneider,
Karl Heinz Böhm, Magda Schneider (sa mère dans la
vie) et Uta Franz. Lors d’une fête donnée
à la cour impériale de Vienne, un amour va naître
entre la fille du roi de Bavière, la princesse Sissi
et le jeune empereur François Joseph. Non content de
nous avoir fait valser, le metteur en scène récidivera
en 1956 avec « Sissi impératrice »
et en 1957 avec « Sissi face à son destin ».
Le couple sera presque heureux et un bout de choux naîtra.
Que demande le peuple ! Lorsque le film passait en province,
je vous assure qu’il fallait réserver. Le moins
que je puisse noter, c’est que la vie d’errance
de l’impératrice Elisabeth n’est pas retracée
dans cette trilogie. Mais par principe, il faut voir tous les
films avec Romy Schneider. Dommage qu’elle n’ait
choisi ensuite que des rôles misérabilistes. Elle
était belle, fragile, avec la voix d’un ange…
tout ce qu’il ne faut pas être dans un monde de
prédateurs.
|
|





|
|
| |

|
|
 |
 |
 |
|
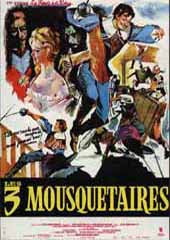
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Arletty
1898-1992 |
|
|
|
| |






|
|
S’il
fallait donner un qualificatif à Arletty, ce serait
: inimitable ! Une gouaille naturelle, une présence
attachante, on avait vite fait de se laisser prendre dans
ses filets. Une exception dans le cinéma français.
Elle vint au septième art lentement, sans aucune certitude,
comme poussée par les chalands. Elle était belle
avec une certaine gravité dans le regard, royale dans
tous ses rôles. L’esprit vif, tour à tour
calme ou moqueuse, nimbée d’une grande poésie,
mais toujours avec ce maintient inoubliable. Dommage qu’elle
fut souvent confinée dans les mêmes stéréotypes.
Arletty, c’est Paris en toile de fond, la gare de l’Est,
le grand escalier de pierre qui rejoint la gare du Nord et
surtout, le fameux canal Saint-Martin !
Arletty – Léonie Bathiat – naît à
Courbevoie le 15 mai 1898. Une enfance heureuse, coupée
de séjours en Auvergne. Premier choc en 1914, son amoureux
meurt à la guerre ; il avait les yeux si bleus
qu’on l’appelait Ciel. Elle décide
de ne jamais se marier et de ne pas avoir d’enfants
pour n’être ni veuve de guerre ni mère
de soldat. Elle ne manquera pas à sa parole. Second
choc en 1916 à la mort de son père. Elle se
retrouve seule avec sa mère, tourneuse d’obus,
c’est à cette époque qu’elle devient
dactylo puis mannequin.
Paul Guillaume, le marchand d’art qu’elle rencontre
par hasard, lui ouvre les portes du théâtre avec
deux recommandations : l’une pour l’Odéon,
l’autre pour les Capucines ; elle choisit le théâtre
des Capucines, considéré à l’époque
plus mondain. C’est son directeur, Armand Berthez, qui
lui trouvera son nom de scène. Elle traverse avec plus
ou moins de bonheur les années folles, joue dans ces
revues aux couplets irrévérencieux qui passent
au crible l’actualité politique et scandaleuse
et se hasarde aussi au cabaret. En 1928, elle s’épanouit
dans l’opérette avec « Yes »
de Maurice Yvain puis « Azor » en 1932
et « Un soir de réveillon » de
Raoul Moretti. Suivra « Ô mon bel inconnu »
de Reynaldo Hahn et en 1934 « Le bonheur, mesdames ! »
de Christiné. Colette décrira son regard
chaviré et sa séduction directe !
Elle débute au cinéma en 1930 dans « La
douceur d’aimer » de René Hervil et
récidive en 1931 dans « Un chien qui rapporte »
de Jean Choux (un véritable navet !). Tout prend
forme à partir de 1936 quand l’auteur Édouard
Bourdet l’associe à Victor Boucher et Michel
Simon dans sa pièce de théâtre « Fric-Frac »
et c’est là que le triomphe arrive. Comique de
truands et argot inoubliable à usage des gens du monde.
En 1939, Fernandel remplace Victor Boucher pour l’adaptation
cinématographique de Maurice Lehman et Claude Autant-Lara
où elle sera sublime de malice et d’autorité.
Guitry, qui ne s’entourait pas de n’importe qui,
l’intègre au prologue de « Faisons
un rêve » en 1937, il ira même jusqu’à
la noircir pour le rôle de la reine d’Éthiopie
dans « Les perles de la couronne » en
1937 ! La même année, elle sera une soubrette
dans « Désiré ».
Elle n’oubliera jamais le théâtre. Avec
Cocteau, ce sera « L’école des veuves »,
avec Guitry « Crions-le sur les toits »,
sa présence remplira l’ABC et le théâtre
de la Madeleine.
C’est sur le plateau de « Pension mimosas »
en 1934 qu’elle rencontre Marcel Carné alors
qu’il est l’assistant de Feyder. En 1938, il lui
propose un chef d’œuvre : « Hôtel
du Nord » sur des dialogues d’Henri Jeanson.
Avec cette réplique : « Atmosphère,
atmosphère… Est-ce que j’ai une gueule
d’atmosphère ? », le duo Arletty/Jouvet
fera le tour du monde. C'est également de ce film est
tiré cette expression succulente : « Pas
folle la guêpe ! »
Vient ensuite, en 1939, le film de Jean Boyer « Circonstances
atténuantes » dans lequel Arletty fredonne,
sur un air de java : « Comme de bien entendu »
Je l’entends encore ! Elle chantera aussi dans
« Tempête » de Bernard Deschamps
en 1940. Suivra un grand film, triste à souhait, «
Le jour se lève » de Carné en 1939 et
« Madame sans gêne » de Roger Richebé
en 1941. Une seule personne l’égalera plus tard
dans ce rôle, ce sera Jacqueline Mailland.
Puis ce sera un personnage androgyne dans « Les visiteurs
du soir » en 1942 et elle sera l’inoubliable Garance
dans : « Les Enfants du Paradis » en 1944. Un
chef d’œuvre du cinéma français !
La période trouble de l’occupation et sa fréquentation
d’un haut gradé de l’armée allemande
l’associent à la fine fleur de la collaboration
et annoncent les prémices du déclin de sa carrière.
Les nuages s’amoncellent à la Libération,
ce sera la prison. Elle aura cette phrase décapante
: « Mon cœur est français, mon cul est international
! » Elle accepte tout sans broncher mais son aventure
aura malgré tout des retombés sur sa carrière
même si Prévert et Carné lui restent fidèles.
Sa pénitence achevée, elle revient au théâtre
avec « Un tramway nommé désir »
en 1949, puis dans « La descente d’Orphée
» en 1959, « Un otage » en 1962 et la reprise
de « Les monstres sacrés » en 1966. Le
cinéma la délaisse. Elle avait été
émouvante dans « L’air de Paris »
de Carné en 1954, elle fut irrésistible dans
« Maxime » de Verneuil en 1958. Ces derniers films
annoncent son crépuscule, la nuit s’abat sur
ses yeux... Elle aura quitté la pleine lumière
de la gloire pour l’obscurité. Elle s’éteint
à Paris, le 23 juillet 1992.
Pour moi, elle restera un Sphinx aux foudroyants éclats
de rire... Il y a dans le ciel une étoile de plus !
|
|





|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
suite…
|
|
|
|
|