| |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
Entracte
: |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |




|
|
Avant
d’être un excellent réalisateur, José
Giovanni est un remarquable écrivain. Jean Cocteau ne
s’y était pas trompé quand il écrivait : « J’exprime
ma reconnaissance à l’auteur d’un livre qui
m’a ému : Le Deuxième Souffle. C’est
une manière de chef d’œuvre ; l’intrigue,
la langue, la noblesse des âmes, tout est remarquable ! »
Ce livre avait été publié dans la fameuse
Série noire, dirigée par Marcel Duhamel.
L’année précédente, Roger Nimier
avait fait paraître chez Gallimard « Le Trou »
que Jacques Becker réalisera en 1959 avec dans les rôles
principaux Raymond Meunier, Michel Constantin et Jean Keraudy.
Giovanni avait adapté les dialogues et en était
le conseiller technique.
Né le 22 juin 1923 à Paris, José Giovanni
voit ses études interrompues par la guerre, une période
riche en dérives dangereuses qui ne devait pas l’épargner.
Il s’écarte des sentiers de la légalité
et connaît la prison dont il sort à l’âge
de trente-trois ans, après avoir échappé,
grâce à son père, à la peine capitale.
Il lui rendra hommage, regrettant de n’avoir su le faire
de son vivant, dans son roman « Il avait dans le
cœur des jardins introuvables » qu’il
adapte à l’écran en 2000 sous le titre « Mon
père, il m'a sauvé la vie ! ».
Son roman « Le Trou » est inspiré
de sa tentative d’évasion.
À sa sortie de prison, il songe à quitter la France
pour l’Australie mais son visa d’immigration lui
est refusé et c’est grâce à ce refus
qu’il écrira dans la Série noire.
Après « Le Deuxième Souffle»
viendront « Classe tous risques » et « L’Excommunié
» en 1958, « Histoire de fou » en 1959, «
Les Aventuriers » en 1960, « Le Haut-Fer »
en 1962, « Ho ! » et « Meurtres au sommet
» en 1964, « Les Ruffians » en 1969, puis
« Mon ami le traître » en 1977 et «
Le Musher » en 1978. L’une des forces de Giovanni,
c’est son univers typiquement personnel. Ses romans n’ont
rien à envier aux plus grands romans étrangers.
Il inspirera Claude Sautet pour « Classe tous risques
» en 1960 avec Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo, et
Jean-Pierre Melville pour « Le deuxième souffle
» en 1966 avec Lino Ventura, Paul Meurisse et Raymond
Pellegrin. Mais il comprend très vite que pour traduire
son univers viril, humaniste, il sera mieux servi par lui-même
! En 1966, il passe derrière la caméra. Ce sera
« La loi du survivant » un film qui évoque
l’univers moral des truands corses, puis en 1968 «
Le rapace » avec Lino Ventura immergé dans une
révolution d’Amérique du Sud pour abattre
un dictateur. Pour moi, son chef d’œuvre, c’est
« Dernier domicile connu » de 1969, avec Lino Venture,
Paul Crochet, Marlène Jobert. Le collaboration entre
un policier désabusé et une jeune débutante
pleine d’illusions à la recherche d’un témoin
capital. Étonnant Paul Crochet dans la séquence
des comprimés bleus ! Suivra « La Scoumoune »
en 1972, avec Belmondo, Michel Constantin et Claudia Cardinale,
une saga sur une vie : deux amis, la pègre d’avant
et d’après la guerre, toujours la prison, une libération
sous condition : déminer des plages françaises,
avec l’accident, le déclin, l’amitié
virile toujours. En 1978, il retrace dans « Les Égouts
du paradis » le célèbre cambriolage d’une
banque niçoise par Albert Spaggiari. Puis Giovanni va
s’en prendre au système judiciaire dans «
Une robe noire pour un tueur » en 1980 et par la même
occasion, aux méthodes policières douteuses. Il
ne fera d’ailleurs pas dans la nuance et produira ici
une œuvre forte.
Il considérait que ses films tournaient en vase clos,
qu’ils ne montraient que des truands entre eux. Cela,
parce qu’autrefois l’aventure était dans
la pègre alors qu’aujourd’hui, l’aventure
est dans la rue, tout est relié à la société,
peut-être à cause du terrorisme et qu’il
est sans doute illusoire d’isoler les truands des honnêtes
gens ! Cette phrase résume assez bien Giovanni et se
confirme dans « Mon ami le traître » en 1988,
co-écrit avec Alphonse Boudard. Grande réflexion
sur le concept de la trahison !
José Giovanni est mort à Lausanne le 24 avril
2004. Il nous a laissé vingt romans, deux livres de souvenirs,
plus de trente scénarios et une vingtaine de films et
téléfilms. En mars 2004, il reçut le 15e
prix Simone-Genevois pour son livre « Mes grandes gueules
». Il avait trouvé avec le compositeur François
de Roubaix, un innovateur qui a su donner une marque à
l’illustration sonore de ses films.
Cocteau avait raison : Monsieur José Giovanni, vous êtes
un grand écrivain et un merveilleux cinéaste !
|
|




|
|
| |
 |
|
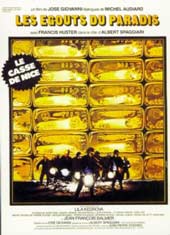 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |




|
|
Le
monde des Indiens a été souvent caricaturé
au cinéma. Dans une interview, Kevin Costner a dit :
« Il faut démystifier le rôle que le cinéma
a donné aux Indiens tantôt bons tantôt méchants
! » il a ajouté : « Je suis moi-même
d’origine indienne et je sais qu’ils peuvent être
cruels. Ils n’avaient aucune pitié pour ceux qui
leur servaient d’esclaves, pas plus que pour leurs prisonniers.
Entre tribus, ils se livraient souvent une guerre fratricide
! » J’ajouterai que les seuls qu’ils laissaient
en paix étaient les malades mentaux ! Ils les craignaient,
par superstition, et les fous qui vivaient au sein de la tribu,
sans contrainte d’aucune sorte, étaient même
respectés.
Une véritable saga épique, le film avec Kevin
Costner devant et derrière la caméra de 1991 :
« Danse avec les loups » d’après le
roman de Michael Blake, avec également Mary McDonnel,
Graham Green, Rodney A. Grant !
Pendant la guerre de sécession, un soldat nordiste –
Dunbar/Costner – grièvement blessé, échappe
à l’amputation en prenant la fuite. La scène
qui s’ensuit, une tentative de suicide camouflée
en baroud d’honneur étrange, entre les deux armées
face à face, nordiste et sudiste, est surréaliste.
Son acte va changer le cours de la bataille, il devient un héros.
Il demande à être affecté à un avant-poste,
à la lisière du territoire Sioux encore déserté
par les blancs et là, dans une cabane oubliée
de tous, il devient le seul représentant de l’Amérique,
avec pour compagnons un loup et un journal dans lequel il consigne
ses journées. Sa rencontre avec une Indienne blessée,
la jeune veuve d’un guerrier, une femme blanche rescapée
d’un massacre qui a grandit dans la tribu, qu’il
va aider, le rapproche des Sioux. Premier contact, échange
de cadeaux. Elle lui sert d’interprète, lui apprend
la langue Lakota. Il sera désormais « Danse avec
les loups ». L’intégration sera totale, il
épousera même la belle ! Si l’approche des
Sioux est pesante, les liens qui se tissent entre eux rendront
le citoyen irrécupérable, perdu définitivement,
et non seulement dans un endroit abandonné de Dieu mais
surtout pour l’Amérique. C’est un film puissant,
bien construit, qui prend aux tripes et le plus étonnant,
c’est qu’il ne fait l’apologie de personne.
Ni du courage, ni de l’Amérique, pas plus des Indiens.
Kevin Costner a posé le doigt sur les vrais problèmes.
Comment la fraternité humaine peut-elle exister au milieu
de deux pôles contradictoires, la guerre et la paix ?
Qu’est-ce que la civilisation, la sauvegarde de la nature
? Où en sommes-nous avec le racisme ? Ce n’est
pas un film idyllique, c’est un film souvent violent,
cruel, comme l’était cette époque. Décidément,
l’homme est plus dangereux pour ses semblables que le
loup. L’esthétique du film renoue avec la tradition
des grands westerns mais en renouvelant le genre. Pour un débutant,
c’est une belle réussite.
Je me suis demandé si Costner ne s’était
pas inspiré de « Un homme nommé cheval »
réalisé par Elliot Silverstein en 1970, le principal
point de jonction entre ces deux films étant l’approche
lucide de l’être humain. Aussi, pour finir, un mot
de « Un homme nommé cheval » (A man called
horse) avec Richard Harris, Jean Gascon et Judith Anderson.
C’est en fait, une série de trois films (à
ne pas confondre avec « Le convoi sauvage » qui
y fut cependant rattaché) qui composent l’histoire
en épisodes d’un aristocrate anglais venu pour
une partie de chasse, capturé par les Sioux, qui voit
sa transformation inéluctable. Après de multiples
humiliations et l’initiation au soleil, il devient indien
dans l’âme.
Dans l’épisode suivant « La revanche d’un
homme nommé cheval » (Return of a man called horse)
du réalisateur Irvin Kershner, de 1976, avec Richard
Harris, Gale Sondergaard et Billy Lochking, le lord anglais
retourne dans le Dakota pour venger ses amis indiens.
Il sera suivi d'un troisième volet « Le triomphe
d’un homme nommé cheval ».
Mais si je devais partir sur une île déserte, j’emporterais
« Little Big Man » du réalisateur Arthur
Penn, de 1970, avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Martin Balsan
et Chief Dan George, d’après le roman de Jack Crabb.
Il faut bien avouer que le récit fait par un homme âgé
de cent vingt ans évoque de façon fantaisiste
la conquête de l’Ouest. Mais ce film est magique
! Il nous prend là où nous avons ce que nous supposons
posséder : un cœur, des émotions, des rêves
! On s’en fout que cette histoire soit vraie ou non, le
tour de force est d’avoir fait un film plausible où
l’évocation théâtrale est poussée
à son paroxysme. On vole au-dessus des plaines, en compagnie
de l’oiseau tonnerre, on est très vite pris dans
la couleur, l’odeur et le son du film comme dans un délicieux
tissu qui nous draperait. Il est envoûtant tout en nous
renvoyant aussi aux frayeurs de notre prime enfance lorsque
Dustin Hoffman et Faye Dunaway, enfants, sont cachés
sous un chariot bâché, la peur au ventre, voyant
le massacre des colons s’organiser. Ce ne sont pas les
Indiens qui sont effrayants mais leurs pieds qui s’activent
dans un bal apocalyptique ! Grand film pour grands rêves,
les nôtres !
Je vous souhaite, malgré tout, une bonne nuit ! |
|
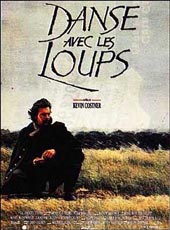

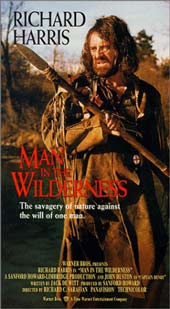
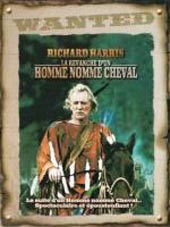
|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
George
Catlin 1796-1872 |
|
|
|
| |


|
|
Lorsqu’on
a la passion des Amérindiens, on ne peut omettre celui
qui les a peints avec autant de talent et de réalisme
: George Catlin. Bien sûr, je sors un peu ici du cadre
du cinéma mais n’est-il pas le premier à
les avoir fixés sur une « pellicule » ?
C’est sans doute les histoires sur les Iroquois que sa
mère lui racontait qui donne à Catlin l’envie
de connaître et de faire connaître les Indiens d’Amérique.
Il abandonne une carrière juridique pour devenir peintre,
plus particulièrement portraitiste à New York.
À partir de 1839, il parcourt les grandes plaines à
la recherche des tribus de l’Ouest et il rapporte, en
plus de l’amitié d’un jeune sioux, une multitude
d’esquisses et de dessins qu’il terminera à
Albany, dans son atelier. Plus tard, il lui viendra l’idée
malicieuse pour faire connaître les Indiens, de réunir
ses peintures et sa collection d’objets indiens et de
parcourir dans un premier temps, les Etats-Unis puis en Europe,
l’Angleterre et ensuite la France… avec six tonnes
de matériel ! À Paris, en 1845, Louis-Philippe
le fait accueillir au Louvre, lui commande quinze toiles et
c’est la révélation ! La ville découvre
les « sauvages ». Le succès est total, les
curieux insatiables. Accordons aux Français une pâle
excuse, ils ne les connaissent que par la tradition littéraire
! En 1846, George Sand parle de lui dans son journal et lors
d’une exposition, Delacroix dira d’eux : «
Ils sont Homériques ! » et fera des croquis. C’est
Baudelaire qui lui donne des lettres de noblesse en l’évoquant
dans sa critique d’art. L’accueil de Paris est exceptionnel.
Sans doute est-ce la nouveauté qui captive les foules
et l’originalité du thème, comparé
à l’art du moment qui fait réfléchir
les artistes.
Il meurt en 1872 et… ce n’est qu’en 1879,
mais un peu tard, qu’arrive la consécration. L’œuvre
de Catlin entre dans les collections nationales de la Smithsonian
Institution à Washington où elle est toujours.
Si le bruit avait couru avant l’exposition de 1846 que
Catlin « ne savait ni peindre ni dessiner, et que s’il
avait fait quelques ébauches passables, c’était
grâce à son courage et à sa patience »
on sait maintenant qu’il a peint les Indiens Osages, les
Iroquois et les Pawnees comme personne et que, plus important
encore que la peinture en elle-même, son travail minutieux
d’ethnographe est irremplaçable ! Je peux vous
dire sans risquer de me tromper que Catlin fut un futuriste
imprégné d’une implacable lucidité
car, déjà, il était conscient que leur
avenir annonçait leur disparition ! En observant l’ombre
qui voile le regard de ces Indiens, on a la certitude que Wakan-Tanka
ne veillera pas éternellement sur eux !
|
|


|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |




|
|
Nous
avons tous une préférence pour tel ou tel metteur
en scène, par affinité, je pense… De Cukor
à Lang, la mienne va à Billy Wilder, dit «
Billy », un metteur en scène d’une rare efficacité
qui a globalement réduit les mobiles humains à
l’argent et à la sexualité. Et c’est
sans doute cela qui donne un tel ressort à ses effets
comiques.
Billy Wilder est né en Autriche en 1906. On peut dire
qu’il est lui-même un personnage de film. Après
avoir tenté des études de droit, il gagne Berlin,
pour être danseur mondain et journaliste. À partir
de 1927, la UFA l’emploi. Il écrit des scénarios
; en 1929, celui de « Les Hommes le dimanche » de
R.Siodmak, viendront ensuite des policiers, des comédies
(certaines, musicales) et des textes frivoles, parfois des adaptations
de livres populaires tel « Émile et les détectives
» de G. Lamprecht de 1931. C’est une époque
trouble, les nazis viennent tout perturber alors il se réfugie
à Paris. En 1934, il aborde la mise en scène avec
Alexander Esway pour « Mauvaise Graine ». Avec d’autres
candidats à l’exil, il se laisse tenter par l’Amérique
mais de mauvaise grâce car il ne parle pas un mot d’anglais.
Il commence par traduire les textes déjà écrits
en Europe qu’il avait apporté dans ses bagages
et reste un moment confiné dans un travail de scénariste
pour d’autres réfugiés : Deterle, May, Thiele.
La rencontre avec Charles Brackett lui permet de remporter ses
premiers succès de dialoguiste avec une suite impressionnante
: « La huitième femme de Barbe-Bleue » et
« Ninotchka » de Ernst Lubitsch, en 1938, ensuite
de Mitchell Leisen « La Baronne de minuit » en 1939
et, « La Porte d’or » en 1941, puis «
Boule de Feu » de Howard Hawks en 1941. Il continuera
d’écrire jusqu’en 1950.
Ses traits d’esprit et ses éclats humoristiques,
dans la vie comme au cinéma, n’ont rien de superficiel,
ils servent sa construction narrative. S’il porte sur
le monde un regard satirique, ses premières œuvres
dramatiques et policières inclinent vers la misanthropie.
Il dénoncera toujours les illusions et les tricheries
d’Hollywood avec pour meilleur exemple « Boulevard
du Crépuscule » en 1950 avec Gloria Swanson et
Erich von Stroheim, le thème de la star déchue,
un thème qu’on retrouvera plus tard dans «
Fedora » en 1978, qu’il produit en Allemagne faute
de financement américain.
Mais rien ne lui échappe ! Ni les mensonges du journalisme
avec « Le Gouffre aux Chimères » en 1951
avec Kirk Douglas et Jan Sterling, ni les machinations de l’être
humain dans « Assurance sur la mort » en 1944, crime
crapuleux et assurance-vie. Tout y passe ! « Si l’on
ne peut pas jurer que tout le monde est corrompu, c’est
parce que nous ne connaissons pas tout le monde ! » disait-il.
On pourrait résumer sa vie par cette phrase. Belle pirouette
tout de même !
Viendront ensuite « Stalag 17 » en 1953, une tentative
d’évasion pendant la seconde guerre mondiale qui
sera reprise dix ans plus tard dans « La grande évasion
» de John Sturges avec Steve McQueen, puis « La
Garçonnière » en 1960, un film tinté
de dégoût, intérêt, compromission
et quiproquo amoureux, puis « Un, Deux, Trois »
en 1961 avec pour thème les marchés à conquérir
en période de guerre froide ! Il se complaira toute sa
vie dans son rôle de moraliste, il avait commencé
depuis longtemps avec « La scandaleuse de Berlin »
en 1948, une enquête sur la moralité des troupes
américaines.
Je vous ai gardé pour la fin mes deux préférés
« Irma la douce » de 1963 avec Shirley Mac Laine
et Jack Lemmon, un gardien de la paix qui se déguise
en lord pour sortir sa belle du ruisseau et « Embrasse
moi idiot » de 1964, un chanteur de charme et une entraîneuse
déguisée en fausse épouse. Tout un programme
! Mais, où ai-je la tête ? J’allais oublier
« Certains l’aiment chaud » de 1959, avec
la grandiose Marilyn Monroe, et le tandem Tony Curtis et Jack
Lemmon ! Qui ne se souvient pas des deux musiciens au chômage,
contraints de se travestir pour échapper à des
gangsters, enrôlés – l’instinct de
survie ! – dans un orchestre féminin où
ils tombent amoureux d’une créature de rêve
qui ne pense qu’à séduire un millionnaire.
Combien de beaux portraits de la faiblesse humaine aura-t-il
laissés ! Il ne se lassa jamais de dénoncer la
froideur du système de la société, c’est
probablement le metteur en scène qui aura fait, sous
couvert de comédie, la plus terrible critique de son
époque. Ses derniers personnages semblent lui être
plus sympathiques mais il ne dérogera jamais à
la morale. Pour lui, le seul juge était son public, bien
qu’il lui soit arrivé parfois de le surestimer
car « Embrasse moi idiot » fut un échec,
qui fit même scandale ! Le fait de ne s’être
jamais politiquement engagé lui aura apporté une
totale liberté d’action. L’ère du
Jazz et cet air de Paris qu’il aimait adouciront certains
de ses films, comme dans « Irma la douce ».
Je crois qu’on pourrait le résumer en disant que
son art le rendait capable de conduire le spectateur dans sa
parade cinématographique. Je terminerai, ce soir, sur
le souvenir de la sublime Marlène Dietrich dans «
La scandaleuse de Berlin ». Plénitude visuelle,
activité intense et ingénieuse, grâce perverse.
Un grand du cinéma américain !
|
|




|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |

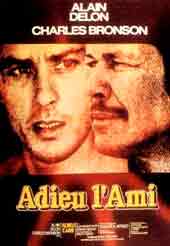




|
|
Quand
je songe à la violence qui s’est emparée
de notre époque, je soupçonne le cinéma
de ne pas y être pas étranger. Nous avons, bien
entendu, notre libre arbitre mais… que faisons-nous au
juste de cette liberté ? Le champ d’action à
notre portée, nous permet-il de réagir sainement
? Quant aux jeux vidéo, qu’en est-il vraiment ?
On aimerait croire en leur innocence mais un fait divers venu
des États-Unis nous en ôte tout espoir : le jeu
s’est substitué à la réalité
dans le subconscient d’un enfant qui, après avoir
intégré une image scannée de ses parents
dans le rôle des méchants, finira par les tuer,
dans le jeu et dans la vie ! Ils étaient devenus de véritables
ennemis.
Mais, me direz-vous… s’il avait visionné
« À bout portant » de Don Siegel, de 1964,
que j’évoquais dans la 6ème séance,
peut-être aurait-il eu ce même goût de violence
en bouche ! Ce film, remarquable au demeurant, tiré d’une
nouvelle d’Hemingway relate l’histoire anecdotique
d’exécuteurs froids comme ceux qui sévissent
de nos jours. Il est évident que je lui préfère
« Absence de malice », un polar de Sydney Pollack,
de 1981, avec Sally Field et Paul Newman (toujours magistral
!) dans le rôle du fils d’un gangster qu’un
policier de Miami va tenter de compromettre, sans preuve, en
manipulant la presse. Malheureusement pour le flic, tel sera
pris qui croyait prendre. À noter que la traduction du
titre en français semble être un contresens car,
en anglais, « malice » signifie « préméditation
», et « absence of malice » est, aux États-Unis,
une clause prévue pour protéger les journalistes
!
S’il est un film sordide qui s’inscrit dans le droit
fil du film policier, c’est bien « À coups
de crosse » de Vincente Aranda, de 1984, avec Fanny Cottençon
et Bruno Cremer en policier violent qui séduit une fille
dont l’amant est en prison. Tout ça pour découvrir
une cache d’armes !
Heureusement que des films comme « Adieu l’ami »
de 1968, de Jean Herman, d’après le roman de Sébastien
Japrisot, avec Charles Bronson, Alain Delon et Olga Georges-Picot
relèvent la cote des polars. Deux hommes se laissent
enfermer dans une banque pendant le temps d’un week-end,
l’un pour vider un coffre-fort bien rempli et l’autre
pour y remettre en place des documents, sans savoir qu’ils
sont entraînés dans un piège. Il naîtra
de leur association une véritable amitié.
L’un des fleurons du film noir est sans conteste «
Adieu ma belle », tiré du roman de Raymond Chandler,
de 1945, avec Claire Trevor et Dick Powell, qui propulsera Edward
Dmytryk en tête d’affiche, le faisant sortir des
séries B. Philip Marlowe sera mêlé à
une enquête sur la petite amie d’un truand et à
une affaire de bijoux volés. Son remake, de Dick Richards,
en 1975, fut intitulé « Adieu ma jolie ».
Avec Charlotte Rampling au menu et l’étonnant Robert
Mitchum (lorsqu’il est à jeun), il ne pouvait pas
être nul !
Je placerais « La dame sans passeport » de Joseph
H. Lewis, de 1950, avec Hedy Lamarr et James Craig dans le registre
des films séduisants : à Cuba, alors qu’il
tente de démanteler un réseau hongrois d’immigration
irrégulière, un officier américain tombe
amoureux d’une belle femme sans passeport qui va être
prise en otage par le réseau. Que d’émotions
en perspective !
Dans le registre des policiers français, « Cécile
est morte » de Maurice Tourneur, de 1944, adapté
d’un roman de Georges Simenon, avec Albert Préjan,
Santa Relli, Gabriello, Germaine Kerjan mériterait une
mention particulière. On pénètre ici dans
la parapsychologie. Maigret devient un peu le confident d’une
jeune femme sans histoire qui, sans être prise au sérieux,
vient régulièrement lui confier ses craintes.
Un jour, sa tante est assassinée et Cécile disparaît
après avoir laissé une note sur le bureau de Maigret.
Mais pour moi, le policier français passe inévitablement
par José Giovanni. Je compléterais donc maintenant
la 13éme séance avec « Le Gitan »
de 1975. Avec Alain Delon, Annie Girardot et l’inoubliable
Paul Meurisse ! Encore, bien sûr, un film basé
sur l’amitié : pour venger son peuple de la société
qui le condamne à une condition d’errants endémiques,
un gitan multiplie les hold-up pour reverser les subsides aux
siens. Le hasard le conduit irrévocablement à
croiser le chemin d’un ancien truand, Paul Meurisse, dont
il perturbe la retraite. Toujours le même flegme chez
Paul Meurisse qui contraste avec la vivacité du personnage
principal. Annie Girardot magnifique, égale à
elle-même !
La classe s’allie au suspense avec Alfred Hitchcock, un
des grands maîtres du genre pour « L’inconnu
du Nord-Express » de 1951, avec Farley Granger, Robert
Walker et Ruth Roman. Un échange de meurtre qui sera
souvent reprit au cinéma. Avec Hitchcock, on est au sommet
de l’effet dramatique sans effusion de sang.
On retrouve la même classe, mais avec un écho différent,
dans « Les inconnus dans la maison » d’Henri
Decoin, de 1942, avec Raimu, Juliette Faber, Jean Tissier, Tania
Fedor et Mouloudji adolescent. Encore d’après un
Simenon. Une petite ville de province, trop calme, troublée
par un crime mystérieux. L’avocat, maître
Loursat, qui a sombré dans l’alcoolisme, vit dans
une sinistre demeure bourgeoise dans laquelle sera retrouvé
un cadavre. Pour la petite histoire, ce film qui reste l’un
des grands de la période de l’occupation sera interdit
à la libération parce que le suspect porte le
nom d’Ephraîm Luska et que la plaidoirie de l’avocat
paraît réactiver les arguments du national-socialisme
!
Pour rester dans le suspense, quoi de mieux que « La mariée
était en noir » de François Truffaut, de
1967, avec Jeanne Moreau (l’incontournable veuve !), Michel
Bouquet, Michael Lonsdale, Jean-Claude Brialy, Charles Denner
et Alexandra Stewart. La lente progression de la vengeance de
Julie Kohler, veuve le jour de son mariage, qui décide
d’éliminer ceux qui sont responsables de la mort
de son mari. À l’origine de cette traque sournoise,
une balle perdue qui détruit tout d’abord deux
vies, autant par jeu que par bêtise, puis qui en détruira
bien d’autres !
Avec « Mortelle Rencontre » de Sidney Hayers, de
1974, la cavale est garantie. Avec Hayley Mills et Sterling
Hayden qui ne savait pas que Belle Adams venait de s'évader
d’un hôpital psychiatrique pour criminels. On ne
devrait pas prendre en stop n’importe qui ! Il n’aura
pas eu le temps de le regretter… La randonnée sera
jalonnée de morts bien mystérieuses.
« Nocturne », un film policier bien construit d’Edwin
L. Marin (connu également pour ses westerns) est sans
conteste son film phare. Réalisé en 1946, avec
George Raft, Lynn Bari, Virginia Huston et Joseph Pevney. Il
retrace la traque d’un inspecteur qui ne croit pas au
suicide d’un compositeur de musique et qui va rechercher
la femme mystérieuse dont il parle dans ses chansons.
L’un des plus beaux films de l’histoire du polar
américain est probablement « Quand la Ville dort
» de John Huston, de 1950, d’après le roman
de William R. Bennett. Un film magistral avec Sterling Hayden,
Louis Calhern, James Whitmore et dans un tout petit rôle,
Marilyn Monroe. Un malfaiteur sort de prison pour organiser
un cambriolage scientifique et le financier du coup sera un
avocat. La scène du hold-up constitue un suspense fantastique.
Chaque personnage est un cas. Les motivations des protagonistes
en font vraiment un film à part.
Je vous quitterai ce soir sur un film que j’aime beaucoup.
Une comédie dramatique : « Dangereuse sous tous
rapports » de Jonathan Demme, de 1986, la rencontre de
deux personnages que tout oppose, leur milieu social respectif
et leur philosophie de la vie. Il s’agit de Jeff Daniels,
de Mélanie Griffith et de Ray Liotta – l’ex.
de madame – un petit maquereau sans envergure qui mettra
une belle pagaille. Le film oscille entre gravité et
drôlerie car le jeune cadre, bien sous tous rapports,
s’embarque dans une aventure sentimentale qui le dépasse
dès le début. Il se laisse séduire par
une inconnue sexy qui joue avec lui comme… la souris avec
le chat. Tantôt brune, tantôt blonde, femme double
et superbe, personne ne peut dire à la fin du film qui
est le chat et qui est la souris. Mais soyons sérieux,
qui n’aurait pas envie de se faire croquer par Mélanie
Griffith ?
Bonsoir, rêvez bien !
|
|






|
|
| |

|
|
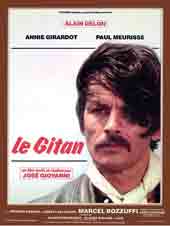 |
 |
 |
|

|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Gene
Tierney 1920-1991 |
|
|
|
| |




|
|
Dans
l’histoire du cinéma américain, Gene Tierney
est une star à part, différente de celles de
sa génération. Sa beauté insolite, son
regard, donne à son aura un attrait particulier. C’est
une bouffée d’oxygène qui nous suffoque
!
Elle est née en 1920, à New York, dans un milieu
social des plus aisés. C’est dans un collège
en Suisse qu’elle découvre le théâtre.
Sans les épreuves qui l’attendaient, elle aurait
pu devenir une de ces ignobles gosses de riches si bien dépeintes
par Scott Fitzgerald.
Zanuck, alors directeur de la Twentieth Century Fox, la remarque
alors qu’elle joue à Brodway. Elle signe avec
lui un contrat de sept ans et débute au cinéma
en 1940 avec « Les trappeurs de l’Hudson »
de Irving Pichel et avec Fritz Lang dans « Le Retour
de Frank James ». Elle tourne trois films en 1941. Avec
« La Route du Tabac » de John Ford, elle incarne
une sourde muette, puis dans « La Reine des rebelles
» de Irving Cummings, elle sera Belle Shirley, une suffragette
de l’époque qui décide de poursuivre le
combat après la défaite des sudistes et enfin,
avec « Shanghaï Gesture » de Sternberg, son
rôle dans l’ambiance glauque des maisons de jeu
lui permettra de casser son image de première de la
classe.
Vient ensuite « Le ciel peut attendre » en 1943,
c’est la rencontre avec Lubitsch ! En 1944, ce sera
avec Otto Preminger pour « Laura », dans le rôle
ambigu de Laura Hunt qui apparaît à un policier
après avoir été assassinée et,
en 1947, avec Joseph Mankiewicz pour « L’aventure
de madame Muir » où elle fait la connaissance
d’un fantôme dont elle tombe amoureuse. «
Laura » et « L’aventure de madame Muir »
seront les deux films les plus marquants de sa carrière
et ceux qui lui auront fait connaître la célébrité.
Elle aura fait trois autres films entre ces deux-là,
dont « Péché mortel » de John M.
Stahl, en 1946, qui lui vaudra une nomination aux oscars.
Ensuite, des chagrins commencent à perturber sa vie
privée. On la voit encore dans des rôles importants
en 1946, dans « Le fil du rasoir » d’Edmund
Goulding, en 1949 dans « Le mystérieux docteur
Korvo » de Preminger et en 1950 dans « Les Forbans
de la nuit » de Jules Dassin mais les scénarios
suivants la font basculer dans les seconds rôles.
Au début des années 50, une profonde dépression
brouille sa vision de la vie, du réel. Les psychiatres
lui conseillent de travailler en dehors du cinéma et
on la retrouve vendeuse dans un magasin. La naissance d’une
petite fille handicapée et son divorce viennent à
bout de sa résistance. Une épreuve qui inspira
Agatha Christie pour son roman « Le miroir se brisa
», une actrice célèbre anéantie
au sommet de sa gloire à cause des conséquences
de la maladie. Après une thérapie, elle retrouve
le chemin des studios de la Métro Goldwyn Mayer et
de la Twentieth Century Fox mais le mal est fait et le milieu
du cinéma ne l’épargne pas. Elle a maintenant
l’étiquette de « star sur le déclin
». Elle aura encore des rôles dans plusieurs films
: en 1953 dans « Affaire personnelle » d'Anthony
Pelissier et dans « Ne me quitte jamais » de Delmer
Daves et, en 1954, dans « L’Egyptien » de
Michael Curtiz.
Elle se remarie avec un homme d’affaire texan et on
ne la reverra encore en 1962 dans « Tempête sur
Washington » de Preminger et, en 1963 dans « Le
tumulte » de George Roy Hill puis, dans son dernier
film, en 1965 « Trois filles à Madrid ».
Ensuite, elle fera quelques apparitions à la télévision
et elle consacrera sa vie aux enfants attardés mentaux.
Gene Tierney est une icône du cinéma américain,
un beau visage étonné dans un monde superficiel
ou les rats ne sont pas que dans les caves ! On prend, on
use, on jette ! On ne se soucie que de l’image et l’on
fait semblant de dire : « On vous aime pour ce que vous
êtes et non pour ce que vous paraissez ! » Bel
édifice d’hypocrisie... Gene Tierney reste pour
moi une belle obsidienne qui su apprivoiser la lumière
et les sentiments.
|
|



|
|
| |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
|
|
suite…
|
|
|
|
|