| |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
Entracte
: |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
Le
cinéma d'animation |
|
|
|
| |



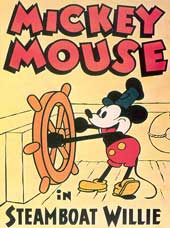



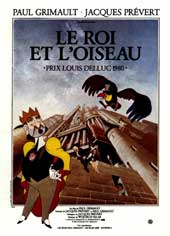
|
|
Le cinéma d’animation me prit par la main très
jeune, place de la cathédrale, à Meaux, devant
la vitrine d’une boutique d’antiquité tenue
par deux vieilles filles, des soeurs. Des personnages bougeaient
sur un cylindre qui tournait et qui m’attirait par sa
luminosité, c’était la répétition
d’un attelage avec un seul cheval. Plus tard, j’appris
que les mémés mentaient en disant que c’était
un objet rare puisqu’il ne pouvait s’agir que d’une
mauvaise copie du zoopraxiscope d’Eadweard Muybridge de
1879... Plus tard, j’ai présenté des films
dans un ciné-club, mais le cinéma d’animation
n’intéressait guère. Pour les enfants
! entendais-je… et même Walt Disney n’eut
guère plus de succès...
La meilleure définition du film d’animation est
certainement l’art d’animer l’immobile, de
créer le mouvement par juxtaposition d’images,
d’objets ou même de photographies représentant
les phases successives d’un même mouvement. Le nom
du procédé, c’est « image par
image », le très connu : 24 images/seconde, la
base du cinéma qui fut suivi par de multiples techniques
: le dessin animé peint à la gouache sur cellulo,
le film de marionnettes ou d’objets animés, la
peinture animée, l’animation de personnages découpés
ou tout simplement de personnages vivants, l’écran
d’épingles, la stéréoscopie, le film
gravé directement peint sur pellicule sans intervention
de la caméra, l’animation par ordinateur, l’animation
de particules ou de matières.
La préhistoire du film d’animation, ce sont les
théâtres d’ombres animées (de Séraphin
en 1770 à Caran d’Ache en 1886), le phénakistiscope
du Belge Joseph Plateau développé entre 1828 et
1832, le praxinoscope d’Émile Reynaud crée
en 1876 avec 12 miroirs (lui succèdera le théâtre
optique qu’il brevètera en 1888) et le fameux zoopraxiscope
d’Eadweard Muybridge de 1879. Arrive ensuite Louis Lumière,
personnage incontournable, créateur du cinématographe.
Il reprit les travaux de Reynaud, l’idée lui paraissait
simple : utiliser des bandes perforées et souples pour
assurer une projection de mouvement continu, sans flou ni sautillement.
Mais qui a vraiment inventé le dessin animé ?
C’est un sujet très controversé, simplement
parce qu’à cette époque, les inventeurs
étaient prolifiques…
En 1906, arrive un procédé qui gardera le nom
de « mouvement américain », Stuart Blackton
vient de réaliser un film qui marquera tous les esprits,
« Humorous Phases of Funny Face », une main dessine
des personnages qui soudain s’animent ! Tout se précipite.
En 1908, Émile Cohl projette au théâtre
du Gymnase, à Paris, son dessin animé « Fantasmagorie
», croyant être le premier et le seul ; il ignorait
avoir été devancé de deux ans par un américain
(vive Internet !…). L’animation est considérée
à cette époque comme un art majeur. C’est
à New York, en 1909, que Winsor McKay projette sur écran
un dessin animé, beaucoup plus élaboré,
qu’il commentera lui-même : « Gertie le dinosaure »
(son Little Nemo sera mis en mouvement en 1911 par Stuart Blackton).
Le cinéma découvrait le dessin animé qui
lui avait donné naissance. En 1924, Earl Hurd déposa
un brevet pour une technique nouvelle, car jusqu’à
présent, les films étaient réalisés
sur papier. Son truc, c’est le traçage à
la gouache sur feuilles translucides, une invention capitale
qui va faire passer l’animation artisanale au niveau industriel.
En 1916, le studio Barre (issu de la Biograph de Thomas Edison)
s’était groupé avec celui de Charles Bowers
; plus tard, ils fonderont les fameux studios d’Astoria
; Earl Hurd, lui, crée celui de la Paramount. En 1927,
il produira « Le fermier d’Alfalfa »
de Paul Terry puis les films de Max et Dave Fleischer. Viendront
ensuite les personnages devenus mythiques : Betty Boop et Popeye.
Plus tard, les studios s’installeront en Floride et ce
sera le début de l’épopée des longs
métrages avec, en 1939, « Les voyages de Gulliver
», et « Douce et Criquet s’aimaient d’amour
tendre » en 1941. À partir de là se crée
une véritable toile d’araignée dans l’industrie
cinématographique d’animation avec ruptures et
créations de nouvelles sociétés.
Et Tex Avery débarque !... aux studios Fox, en 1930,
puis il travaille à la Columbia et à Universal
pour arriver finalement chez Warner Bros qui produira les «
Looney Tunes », une série de dessins animés
où s’enchainent de nombreuses créations
: Bugs Bunny, le canard Daffy, le cochon Porky, Elmer Fudd,
le chat Sylvestre, Speedy Gonzales le souriceau, et ceux qui
m’amusent beaucoup : Bip Bip et le coyote dans leur duo
sado-maso. Mais c’est à un Australien, Pat Sullivan,
que nous devons la première star du dessin animé
: Félix le chat, créé en 1919 en collaboration
avec Otto Messmer. Puis les studios MGM lanceront « Happy
Harmonies » (de Harman et Ising en 1934, avec un personnage,
Bosko, créé alors qu’ils travaillaient pour
la Warner) et grâce à Fred Quimby, ils ouvriront
une unité regroupant de grands noms dont William Hanna,
Friz Freleng et Milt Gross qui aboutira, dans les années
40, à la série explosive « Tom et Jerry ».
Puis arrive le géant : Walt Disney (un empire, cet homme
!). C’est à Kansas City en 1922 qu’il fonde,
avec son frère Roy, le Laugh-O-Grams studio qui fera
rapidement faillite. Ils produisent des féeries animées
dont la série « Alice » et « Oswald
le lapin » (le précurseur de Mickey !) ; et en
1928, le lapin cèdera la place à Mickey Mouse.
Toujours en 1928, vient alors le premier dessin animé
sonorisé « Steamboat Willie » ; puis en 1932,
le premier en technicolor de la série Silly Symphony
: « Flowers and trees ». Maintenant l’idée
de Walt Disney est de produire un long métrage, «
Blanche neige et les 7 nains », mais pour ce faire, il
doit améliorer la technique. En 1937, un an avant «
Blanche-Neige », « Le vieux moulin » voit
le jour, produit avec la caméra multiplane qui apporte
un effet de profondeur. Et l’industrie Disney débute
avec une série de longs métrages prestigieux :
« Pinocchio » et « Fantasia » en
1940, « Dumbo » en 1941, « Bambi » en
1942, « Cendrillon » en 1950, « Alice au pays
des merveilles » en 1951, « Peter Pan » en
1953, « La belle et le clochard » en 1955, «
La Belle au Bois dormant » en 1959, « Les 101 Dalmatiens
» en 1961, « Merlin l’enchanteur »
en 1963, « Le Livre de la Jungle » en 1967. Ensuite,
après sa mort, il y aura encore « Les Aristochats
» en 1970 qui, à mon sens, garderont l’esprit
Disney. Puis, ce sera une autre histoire…
La terre d’élection du dessin animé restera
celle des États-Unis, mais côté français,
n’oublions pas les trucages de Méliès, il
y en eut de fameux, et mon préféré qui
reste Paul Grimault, fondateur de la société Les
Gémeaux d’où sont sortis de purs joyaux
: « Le marchand de notes » en 1941, « La Flûte
magique » en 1946, « Le petit soldat » en
1947. « La bergère et le ramoneur »
verra le jour en 1953, mais un conflit l’opposera à
son producteur, et il ne sortira la version définitive
(sous le titre « Le roi et l’oiseau ») qu’en
1979. Elle se verra couronnée par le prix Delluc. Avec
lui, travailleront de nouveaux réalisateurs : Jacques
Colombat (et son premier court-métrage « Marcel,
ta mère t’appelle » en 1963, «
Robinson et compagnie » en 1991), Jean-François
Laguionie (« La demoiselle et le violoncelliste »
en 1965, « L’île de Black mor » en 2003).
Mentionnons Topor, René Laloux, et Picha, même
si je ne trouve pas tout du meilleur goût… L’animation
française s’enrichira avec la collaboration de
nombreux dessinateurs étrangers : l’Anglais Peter
Foldes, des Polonais comme Borowczyk et Jan Lenica, les Américains
Frank Smith et Jules Engel. Les festivals d’Annecy et
de Zagreb produisent régulièrement des rencontres
et renouvelle les effectifs. Par la suite, les succès
commerciaux d’Astérix domineront largement le dessin
animé français.
Du Canada, je ne garde que Norman McLaren et sa « Poulette
grise » de 1942. Un détour par la Tchécoslovaquie
avec Jirí Trnka et son théâtre de bois,
des marionnettes qu’il met en scène (« Le
rossignol de l’empire de Chine » en 1948, «
Le Brave Soldat Chvéïk » en 1955, «
Le songe d’une nuit d’été »
en 1959).
L’animation en Grande-Bretagne fut longtemps monopolisée
par un couple, John Halas et Joy Batchelor. « La ferme
des animaux » en 1954 leur apportera un moment de gloire
ainsi que « Automania 2000 » en 1963.
Le cinéma d’animation italien a souvent marché
sur les traces de Disney. On peut quand même citer Bruno
Bozzetto pour son premier film, « Tapum, la storia delle
armi » en 1958, « Les deux châteaux »
de 1962 et « West and soda » de 1965.
Avec la Roumanie, un nom s’impose : Ion Popesco Gopo («
Homo sapiens » en 1960).
Pour terminer cette évocation des talents européens,
un détour par la Bulgarie, riche de cinéastes
d’animation : Todor Dinov, Donjo Donev, Ivan Vesselinov.
Pour finir, car on ne peut ignorer le pays du manga, le Japon.
Si certains ont dessiné pour la propagande pendant la
Seconde Guerre mondiale, ils n’en restent pas moins de
grands artistes. Citons « La baleine » de Noburo
Ofugi en 1952, ainsi qu’une fable fantastique et raffinée
« La tristesse de la Belladonna » de Yamamoto Eiichi
en 1973. mais il est infiniment regrettable que ce pays se soit
perdu dans des séries télévisées
aux mouvements simplistes comme « Goldorak ».
Une mention particulière à « Persepolis »
de 2007, de Marjane Satrapi (d’après sa bande dessinée)
et Vincent Paronnaud, réalisé en noir et blanc,
un beau conte moderne sur l'adolescence, l'exil et la différence.
Pour résumer, on peut dire que, même si Walt Disney
dut vaincre à son époque le scepticisme et l’ironie,
l’animation a été et restera un laboratoire
pour le 7e art qui a stimulé les secteurs de pointe de
la recherche. Son plus beau film reste pour moi « Fantasia
». La danse des heures de Ponchielli, ou l’apprenti
sorcier de Paul Dukas… Ça, il fallait le faire
! |
|


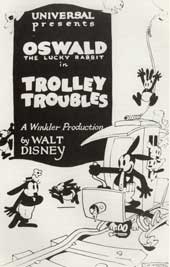
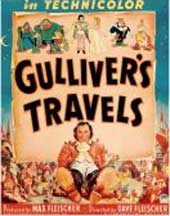

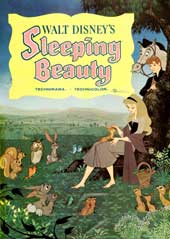
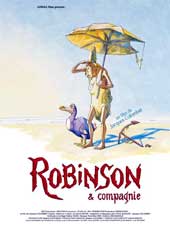
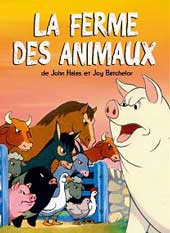
|
|
| |
|
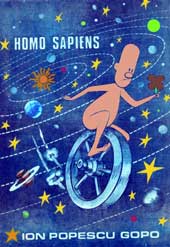 |
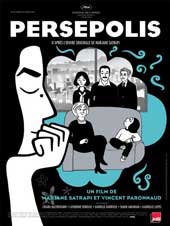
|
|
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
Pretty
Woman - 1990 |
|
|
|
| |
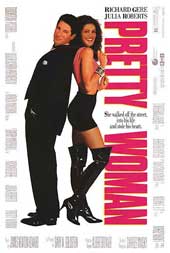



|
|
Ah ! comme il m’énervait cet ami qui disait : «
C’est une pute ! » car il manifestait là
l’un des pires défauts, le mépris.
Ce que j’ai aimé dans « Pretty Woman »,
c’est le rêve qui se réalise. Dans ce film,
Vivian Ward (Julia Roberts) est bouleversante d’opiniâtreté
et Edward Lewis (Richard Gere) va découvrir beaucoup
sur lui-même grâce à cette empêcheuse
de tourner en rond, il ira jusqu’à se fâcher
avec son meilleur ami. N’y aurait-il qu’un pas entre
celui qui se croit le maître et celle qui risque tout
sur la même carte ? Edward Lewis passera d’une neutralité
déconcertante, mélange d’argent et d’ennui,
à la découverte d’un être de chair
et de sang, pétillante de vie, qui va le contraindre
à aller jusqu’au bout de ses désirs. Les
hommes d’affaires auraient-ils une âme ? Dans ce
film… oui ! J’aime ce vendeur à la criée,
au début du film, qui répète : «
Quel est votre rêve ? » Ce « Quel est votre
rêve » donne le ton du film, car sur Hollywood boulevard,
à Los Angeles, il n’y a que des fantômes,
seules Vivian et sa copine semblent vivantes. On passe une mini-jupe
et des cuissardes, un rituel de mauvais goût, et on va
faire le plus vieux métier du monde ! C’est là
qu’elle rencontre un riche homme d’affaires désabusé,
sachant à peine conduire, paradoxe, une voiture de sa
condition. Elle prend le volant, puis viennent les enchères.
L’homme a autant envie de coucher que de se faire pape,
mais Vivian ne se laisse pas impressionner. Dans un premier
temps, elle cherche à lui soutirer le maximum. L’une
des premières scènes, avec pour thème les
préservatifs, est truculente. Je cite : « J’en
ai des rouges, des jaunes, des vertes, des bleues, je suis à
court de violettes ! Mais il me reste une Gold Circle, la capote
des champions. Rien ne passe à travers cette garce !
» Dans la bouche de Vivian, ce n’est pas vulgaire,
c’est comique.
Autre morceau de choix, le directeur de l’hôtel
de luxe où loge le richissime golden boy, Barney Thompson
(impeccablement incarné par Hector Elizondo) qui apprend
les bonnes manières à Vivian. Bien que réticent
au départ (son hôtel n’est pas un hôtel
de passe !), il finira par apprécier cette charmante
jeune femme qui se donne autant de mal pour séduire.
Car Vivian Ward veut un prince charmant, comme cette salope
de Cendrillon (selon les propos de sa copine). Cupidon veille
pendant que la petite araignée tisse sa toile et monsieur
triste mine, l’homme d’affaires implacable, le requin
des rachats d’entreprises en difficulté qui s’est
perdu dans l’âge adulte comme le petit Poucet, prendra
tout son temps (celui du film !), pour perdre sa carapace et
devenir un être normal. C’est un conte moderne entre
guimauve et foire des vanités, un film presque innocent,
plein de tendresse et de retenue. La belle apprivoise la bête
! Dans un monde cynique à pleurer, c’est rafraichissant,
certains diront : trop beau pour être vrai…
Le réalisateur Garry Marshall nous a fait du sucré,
une œuvre totalement irréaliste qui fonctionne très
bien, mais attention, ça ne marchera qu’une fois.
Marshall essayera de reprendre la recette dans « Just
Married », mais la mayonnaise ne prendra pas, car il n’y
a jamais eu qu’une seule Belle au bois dormant, une seule
Cendrillon ! « Pretty Woman » sera, grâce
à Julia Roberts et à Richard Gere, le film le
plus populaire de l’année 1990, il y avait longtemps
qu’Hollywood n’avait pas distillé et répandu
ce petit charme indéfinissable qui fait les soirées
réussies...
Pour l’anecdote, un point reste à éclaircir,
le rôle de l’actrice Shelley Michelle… Bien
sûr, vous avez deviné, c’est la doublure
de Julia Roberts dans les scènes au lit. Les actrices
américaines ne veulent pas que leurs petits défauts
apparaissent à l’écran, c’est dans
le contrat, mais ça ne casse même pas l’ambiance…
Je vous quitte, ce soir, sur deux très belles scènes,
Vivian à l’opéra, émue aux larmes,
et celle de la fin, son prince charmant toujours aussi gauche
(et avec le vertige) qui grimpe pour aller chercher sa belle,
par l’échelle extérieure, un bouquet de
fleurs à la main, sur la Traviata de Verdi, pas même
honteux de la posture ! Le rideau tombe et l’on entend
encore : « Quel est votre rêve ?... »
|
|




|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
James
Dean (1931-1955) |
|
|
|


|
James
Dean, c’est le rebelle, le romantique tué dans
sa course.
Né dans l’Indiana en 1931, son enfance fut une
lente errance d’une ferme du Midwest à la Californie,
puis à nouveau vers l’Indiana à la mort
de sa mère en 1940. Après des études à
Santa Monica et Los Angeles, il apparaît dans quelques
téléfilms puis en 1952, il joue à Broadway
dans « See the Jaguar ». Au cinéma,
on le voit en 1951 dans « Baïonnette au canon »
de Samuel Fuller, en 1952 dans « La Polka des marins »
de Hal Walker et dans « Qui donc a vu ma belle ? »
de Douglas Sirk, en 1953 dans « L’Homme de
bonne volonté » de Michael Curtiz.
En 1954, c’est son interprétation dans «
The immoralist » adapté du roman d’André
Gide qui séduit Kazan pour le rôle de Carl Trask,
l’adolescent incompris, sauvage et malheureux de «
À l’est d’Éden ». James Dean
s’intéresse aux méthodes d’identification
physique et psychologique de l’Actor's Studio et travaille
très sérieusement l’expression corporelle
et ses rôles, mais sa passion, c’est la vitesse
et les courses automobiles, et ce sera son destin.
Peu à peu, son attitude agace. Il arrive en retard aux
répétitions, brocarde la vedette, grossier ou
enjôleur, on le trouve infréquentable. Ce n’est
pas un hasard s’il incarne Jim Stark dans « La Fureur
de vivre » de Nicholas Ray en 1955. Le tournage de «
Géant » tourne au cauchemar, il veut imposer ses
idées à Georges Stevens qui ne le supporte plus.
Les acteurs ne lui adressent plus la parole. Son contrat stipule
qu’il ne doit pas participer à des courses automobiles
pendant le tournage, quinze jours après, le 30 septembre,
il se tue sur la route de Salinas alors qu’il se rendait
à une compétition.
Sa mort déchaine aux États-Unis une hystérie
collective comparable à celle de Rudolf Valentino en
1926. À la différence que Valentino était
idolâtré tandis que la jeunesse américaine
s’était identifiée à James Dean.
Pour la première fois, un très jeune homme incarnant
la même révolte apparaissait à l’écran.
Tous les ingrédients étaient réunis, le
désarroi au changement des valeurs, la guerre froide,
la guerre de Corée qui accentuaient un sentiment de solitude
et d’incompréhension pour une jeunesse qui se cherchait
un avenir. James Dean, avec son allure peu soignée et
sa hargne, était devenu, sans en être conscient,
le porte-parole de cette jeunesse. Accroché à
son fusil dans Géant, et soudainement décroché
de la vie sur la route de Salinas, il était l’errant
dont l’appel se perd dans la nuit. Sa plus grande surprise
fut la mort et cette fois, ce n’était pas du cinéma...
|


|
| |
|
|
 |
 |
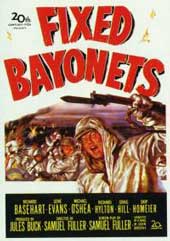 |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
La
vie a un début et une fin, et ce n’est pas toujours
un long fleuve tranquille. Cette thématique se termine
un été qui n’est pas celui de 42…
Je vous quitte sur quelques belles images gravées dans
ma mémoire : le doux visage de Meryl Streep dans « La
maîtresse du lieutenant français »,
la beauté crapuleuse d’Elizabeth Taylor dans « La
mégère apprivoisée », le regard
perdu de Michèle Morgan en Jeanne d’Arc dans « Destinées »,
l’image d’Épinal d’une adolescente
de charme, Greta Garbo dans « La légende de
Gösta Berling », Virginia Cherril en fleuriste
aveugle dans « Les lumières de la ville »
et pour le fun, le chat noir dans son rôle de chat noir
du « Crabe tambour » ! Pour l’anecdote,
l’auteur de ces lignes est de la génération
des « 400 coups » de François Truffaut...
Et pour le happy-end, une courte histoire : On raconte qu’une
belle Américaine se présenta un jour à
la porte du jardin du peintre Claude Monet, à Giverny.
Elle sonne et un homme en tablier bleu, coiffé d’un
chapeau de paille, apparait. « Jardinier, dites à
votre maitre que madame Machin (pour ne vexer personne) est
là. » L’homme répondit : « Mais,
je suis Claude Monet ! » Il paraît qu’elle
n’est jamais revenue...
Le cinéma, c’est la vie, et la vie, c’est
du cinéma ! Je vous souhaite la bonne nuit…
|
 |
| |

|
|
 |
 |
 |
|

|
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
| |

Le Majestic au fil du temps...



Plusieurs
fois évoqué dans ces pages, le théâtre
de Meaux, devenu le cinéma Majestic, a été
inauguré en 1843.
Modernisé dans les années 30, il a été
transformé en multisalles dans les années 90.
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|