| |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
Entracte
: |
|
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| Page
: |
|
Séance
: |
|
|
|
|
Entracte
: |
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
Les
années 90 |
|
|
|
| |
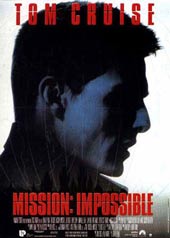



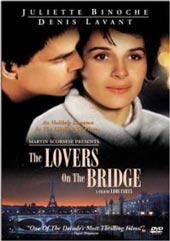


|
|
Il est vrai qu’après 1990, le cinéma ne
m’intéresse plus beaucoup. Trop de violence gratuite,
d’hémoglobine à flot, et des effets spéciaux
souvent contestables reléguant le spectateur au rang
d’enfant arriéré en mal d’explications.
La technique de cette décennie pouvant se résume
à un cinéma truffé d’images à
peine lisibles, et à des plans si accélérés
qu’ils échappent à la perception du spectateur
envoyé comme une boule de billard là où
l’on veut qu’il aille. Et le pire, c’est qu’il
n’en est pas conscient (pour exemple les images subliminales).
Autre exemple, la caméra changeant trop rapidement de
place et de perspective. Pour bien observer certaines scènes,
il faut recourir au magnétoscope et faire des arrêts
sur images. On peut dire que cet engin est l’avenir du
cinéphile qui permet aussi de revoir des œuvres
tombées en désuétude. Un cinéaste
comme David Fincher demande que l’on regarde ses films
4 à 5 fois ! Jouvet, si attaché aux dialogues,
aurait détesté ce cinéma. Les productions
hollywoodiennes sophistiquées sont réalisées
avec l’objectif d’être vue, une fois sur grand
écran, et plusieurs fois chez soi. On peut dire aujourd’hui
que la plupart des films demanderaient trois premières
: projection en salle, projection cassette vidéo, diffusion
sur petit écran. Le rapprochement : télévision/cinéma
était inévitable d’ailleurs, certains téléfilms
comme « Mission impossible » ont donné des
adaptations pour le cinéma ; il n’y a plus
de frontières hermétiques entre les deux médias.
Deux exemples d’acteurs : Helen Hunt et George Clooney
deviennent des stars à Hollywood après avoir été
des stars de séries télévisées populaires.
Aujourd’hui, on fabrique des téléviseurs
dont les écrans 16/9e correspondent au format du grand
écran. C’est la transmission numérique du
son qui a ouvert une nouvelle ère cinématographique.
Par contre, il y a une question humaine que nous devrions tous
nous poser : faut-il prendre au sérieux une lettre d’amour
qui nous arrive sous forme de message électronique ?
Sommes-nous devenus des robots sans nous en être rendu
compte ? On est loin de Lubitsch qui laissait au public ses
facultés d’appréciation. Nous sommes dans
le mensonge de masse, pas étonnant si les politiques
s’en soient emparés. Je ne prendrais qu’un
seul exemple, JFK, gratifié du commentaire de George
Bush, chef de la CIA de 1976 à 1977 : « Je ne sais
pas grand-chose du film, je ne l’ai pas vu. Il existe
des conspirations sur tout, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles
Elvis Presley serait encore vivant. » Signé Bush
! Édifiant non ?...
On considère que le cinéma des années 90
est un cinéma de citations, les réalisateurs se
plaisent à exhiber leurs connaissances cinématographiques.
En 1987, à la fin des « Incorruptibles »,
le réalisateur américain fait allusion à
la fameuse scène du cuirassé Potemkine de 1925
dans laquelle une voiture d’enfant dévale les escaliers.
Pour résumer, de tout temps, seuls les bons films ont
donné envie d’aller au cinéma. J’espère
seulement que l’avenir du spectateur ne passe pas par
cet espagnol : Don Quichotte de la Manche, qui lisait trop de
romans et finit par se prendre pour un hidalgo et se battre
contre les moulins à vent.
Je dois cependant admettre que les années 90 ont produit
quelques petites merveilles. Passons aux choses sérieuses
comme le très bon film d’Oliver Stone de 1991 :
« JFK » ou comment deux hommes peuvent être
touchés plusieurs fois par le même projectile.
Un seul homme, piètre tireur de surcroît, est-il
capable de tuer de loin un homme dans une voiture qui roule
et en plus, avec un mauvais fusil et une mauvaise visibilité.
Jim Garisson (Kevin Costner) procureur de la Nouvelle-Orléans
affirmera que non, c’est impossible. Cette nouvelle dérangeante
implique le fait que Lee Harvey Oswald n’a pas tué
seul le président Kennedy. Pour beaucoup d’Américains,
ce film restera un film de propagande…
Dans le genre « film qui ne fâche pas » style
cinéma-vérité chez les SDF : « Les
Amants du pont Neuf », de Léos Carax en 1991. Une
histoire d’amour entre deux marginaux avec qui la vie
n’a pas été tendre. Michèle (Juliette
Binoche) peintre et presque aveugle a toujours un révolver
dans sa boite à couleurs s’éprend d’Alex
(Denis Lavant), une espèce d’hyperactif asocial
cracheur de feu et toujours défoncé. Ajoutons
à cela un vieux clochard et l’on a un film talentueux
et… misérabiliste. Bonjour Zola ! Léos Carax
n’a pas lésiné sur les moyens, le Pont-Neuf
a été reconstruit, presque grandeur nature avec
quelques façades de maisons le long de la Seine, dont
celle de la Samaritaine, à proximité de Montpellier.
Fatalité ? Le mauvais œil s’est acharné
sur le tournage : mort du producteur, rupture sentimentale entre
Carax et Juliette Binoche, il a fallu trois ans pour achever
le film. C’est le plus cher du cinéma français
: 160 millions de francs. Un film unique, avec des personnages
blessés évoquant les mélos d’avant-guerre.
Pour l’anecdote, Carax s’inspira du film de Jean
Vigo de 1934 : l’Atalante. Certainement, l’un des
plus poignants des années 90 reste « La Liste de
Schindler » de 1993 de Steven Spielberg dont la grande
force a été de montrer l’Holocauste sans
tomber dans la banalité des images surexploitées
et réchauffées. On y voit l’horreur de la
vie de tous les jours dans un camp sous le régime le
plus atroce, celui des nazis, des êtres stimulés
uniquement par la mort. La morale imprègne ce film, on
ne peut décharger ses propres responsabilités
sur quelqu’un d’autre. 1939, la Pologne, la construction
du ghetto de Cracovie et la population juive qui doit s’inscrire
sur des listes. Mais, c’est aussi l’histoire du
personnage fort du film, Oskar Schindler (Liam Neesen), aventurier
et coureur de jupons. On ne peut éviter son insigne du
parti nazi quand il reprend la direction d’une usine pour
le compte de la Wehrmacht, les ouvriers juifs revenant moins
chers que les Polonais. Mais c’est le comptable, en sous-sol,
Itzhak Stern (Ben Kingsley) qui dirige vraiment l’usine,
la tâche de Schindler consistant surtout à soudoyer
les nazis. Au début du film, s’il fait preuve d’humanité,
c’est par intérêt personnel, pour s’enrichir
grâce à une stratégie des plus audacieuses,
la flatterie. Car il a une influence sur le commandant du camp,
un homme sadique qui tire sur les prisonniers par plaisir. Sans
en être vraiment conscient, Schindler va prendre le parti
des Juifs et sa fortune va passer dans le rachat de ses ouvriers.
1100 personnes passeront ainsi à travers les mailles
du filet nazi et l’homme deviendra noble aux yeux des
déportés. Il ira même jusqu’à
faire fabriquer des pièces inutilisables pour l’armement.
À la fin de la guerre, il est complètement ruiné,
il s’enfuit en Argentine. Mais le miracle est pour maintenant,
car le nombre des descendants de ces ouvriers est maintenant
supérieur à la population juive qui vivait jadis
en Pologne.
Passons à un thème différent, « La
leçon de piano », de Jane Campion en 1993 avec
Holly Hunter dans le rôle de Ada McGrath. En 1850, une
femme rencontre son destin à l’autre bout du monde,
en Nouvelle-Zélande, où elle doit épouser
un colon qu’elle n’a jamais vu. L’allégorie
du film, c’est le piano d’autant qu’Ada est
muette. Le futur mari ne comprend pas, il laisse le piano sur
la plage, mais survient un curieux personnage, Georges Baines
(Harvey Keitel), tatoué comme les Maoris, qui vit seul,
un personnage qui évoque ceux de James Fenimore Cooper,
entre deux cultures. Lui seul comprend l’importance du
piano pour Ada et le faux Maori gagnera sa confiance en lui
faisant récupérer son piano ; en contrepartie,
elle lui donnera des leçons et s’en suivront des
moments d’érotisme. Ce film est un judicieux mélange
de violence, de raffinement, de passion et de retenue.
Je terminerai ces années 90 sur un film superbe aux riches
analyses de caractères, « Le Patient Anglais »,
d’Anthony Minghella en 1996, avec Juliette Binoche (Hana),
Kristin Scott Thomas (Katharine Clifton), Ralf Fiennes (le comte
Laszlo Almazy). Le sang du film, c’est le désert
sur lequel des figures humaines vont prendre forme : un calme
troublé par des tirs de DCA, un petit avion s’écrase
et prend feu. Le Patient Anglais, c’est une histoire d’amour
sur fond de mort omniprésente et platonique. Au départ,
l’énigme à cause des brûlures au visage,
à la peau et aux poumons, et la perte de mémoire.
Ce titre de patient anglais lui est donné parce qu’il
est abattu dans un avion anglais par les Allemands. Il ne connaît
ni son nom ni sa nationalité ; seul indice, un livre
d’Hérodote contenant des cartes, des photographies,
des lettres glissées entre les pages. L’infirmière
canadienne Hana (Juliette Binoche) reste avec lui en Toscane
dans un monastère en ruines. Ces souvenirs reviennent,
il est Laszlo Almazy et comte, noble hongrois passionné
par le désert et qui a rejoint un groupe de cartographes
anglais au Sahara. Mais survient un couple d’Anglais et
l’amitié de Laszlo et de Katharine (la femme du
couple anglais) va se transformer en une passion qui conduira
le mari à essayer de les tuer. Il va mourir, Hana peut
montrer ses sentiments… On peut y lire plusieurs niveaux
de narration, la guerre et la souffrance, l’amour et une
forme de désespoir face à la fatalité.
« Le Patient Anglais » trace un point de vue radical
sur la guerre et les hommes qui la font, il développe
des sentiments romantiques sérieux, dénués
d’ironie et renoue avec la grande tradition du cinéma
fait d’intelligence et de sensibilité. Il n’y
a pas de honte à sortir son mouchoir après une
séance de cinéma et sur ce moment fort, je vous
souhaite la bonne nuit ! |
|







|
|
| |
|

|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
Apocalypse
now - 1979 |
|
|
|
| |



|
|
Si certains films crucifient, c’est parce que la peur
est omniprésente. Pour exemple, j’en citerai trois
traitant le même thème et pourtant très
différents : « Né un 4 juillet » d’Oliver
Stone en 1990, et deux autres de Francis Ford Coppola, décidément
obsédé par la guerre du Vietnam, « Garden
of stones » en 1987 et (le pire) « Apocalypse now
» en 1979. En regardant ce qui s’est passé
en Irak, il est facile de comprendre comment basculer dans l’horreur,
mais la question en suspens reste bien : « Pourquoi un
autre Viêtnam ? » À croire que les terreurs
passées n’imprègnent que la conscience universelle,
et ne laissent aucune trace dans celle des puissants…
Inspirée par le récit de Joseph Conrad, «
Heart of Darkness », la trame d’« Apocalypse
now » est simple. En apparence. Le capitaine Willard (Martin
Sheen) est chargé d’une mission dont personne ne
voudrait : il doit débusquer et tuer le colonel Kurtz
(Marlon Brando). Car le colonel Kurtz ne répond plus
au contrôle de ses supérieurs, retranché
dans la jungle, de l’autre côté de la frontière
cambodgienne. Il commande une armée d’autochtones,
Sud-vietnamiens ou soldats américains égarés,
qui se battent pour leur propre compte. En fait, le Viêtnam
proprement dit est bien loin derrière lui, il est au
royaume des morts-vivants, il a quitté notre monde pour
celui qu’il a créé de toutes pièces
et avec ses propres règles. En cela, il nous impose une
autre définition du rapport de l’homme face à
l’horreur et l’on songe à celui qu’il
avait dû être avant de quitter l’Amérique...
Ouvrons une parenthèse, Brando est époustouflant
dans ce rôle de colonel mégalomane à la
limite de la folie, mais c’est un peu simpliste de le
limiter à ces qualificatifs. Dans ce film, tout va crescendo...
Le capitaine Willard remonte le fleuve à travers la jungle
et plus il semble se rapprocher de Kurtz, plus l’horreur
de la guerre prend possession de lui et de ses compagnons. Sur
fond de ballets incessants d’hélicoptères,
et au son de Wagner et des Walkyries, Coppola nous montre l’anéantissement
d’un village pour cause de plage aux vagues parfaites.
Tout a une fin ! Le voyage de Willard s’achève
au royaume des morts, Brando, Bouddha pervers, attend dans l’ombre
comme la mygale. Willard devenu malgré lui une partie
de Kurtz, on ne sait plus où est le bien, où est
le mal. La civilisation n’existe plus, l’essence
de l’homme l’a quitté, nous sommes revenus
aux origines d’un monde étrange. Le rituel de la
mort se met en place, archaïque. Vous finirez par découvrir
le noyau sombre de l’homme, celui qui s’expose dans
les cas extrêmes, celui de la voie royale de Malraux par
exemple. La guerre est une excuse qui fait le lit de l’horreur
et de la folie... Un véritable voyage en enfer, aucun
film des années 70 n’a cette puissance d’évocation.
C’est un moment de pur lyrisme aux frontières d’un
nouveau monde dont il vaudrait mieux ne pas connaitre les aboutissants.
La réussite de Coppola, c’est d’avoir transformé
un film de guerre en tragédie grecque.
La réalisation fut surréaliste. Coppola, en fin
stratège, passa un marché avec le président
Marcos pour pouvoir tourner aux Philippines. À cette
époque, Marcos menait une guerre sans merci aux rebelles
communistes, autant de similitudes, qu’elles soient climatiques
ou guerrières, avec le Viêtnam. Mais rien ne fut
simple. Les hélicoptères quittaient souvent les
lieux de tournage pour de réelles interventions militaires.
Un typhon dévasta les décors sophistiqués,
Martin Sheen eut un infarctus et l’excentrique et obèse
Marlon Brando ajouta le piment nécessaire. Le tournage
dura quinze mois au lieu de quatre. Ce film est un exploit,
on ne releva aucune ingérence du Pentagone qui a l’habitude
de mettre son grand nez dans les films de guerre... Spectaculaire.
Beaucoup y retrouvèrent un Viêtnam bien réel,
celui qu’ils avaient connu...
On sort de ce film déglingué, cloué au
fauteuil. On n’ose croire que des hommes aient pu faire
de telles horreurs sur ordre. Alors, difficile de vous souhaiter
une bonne nuit comme j’ai l’habitude de le faire...
|
|



|
|
| |
|
 |
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |




|
|
Michel
Simon 1895-1975
|
|




|
|
Michel
Simon, c’est une gueule comme personne, une voix éraillée,
une façon de se tenir, de porter la tête comme
les échassiers. Je l’ai croisé lors d’un
vernissage, il semblait flâner plutôt que de vraiment
s’intéresser. À contre-jour dans un coin
de la salle, une petite peinture représentait une horloge.
Le peintre l’interpela : « Venez voir, monsieur
Simon, a-t-on fait plus fin depuis la renaissance italienne
? » Michel Simon s’approcha, se pencha, regarda
et dit simplement : « En effet, je crois bien que les
aiguilles ont bougé ! » C’était cela
Michel Simon, un humour acide mêlé à une
attitude débonnaire.
Il est né à Genève en 1895 et très
jeune, il se démarque par son indépendance, abandonne
rapidement les études et quitte sa famille. Enfant fugueur,
il aime la vie pastorale ; observateur attentif, amoureux de
la nature, il possédait une solide culture marginale
qui ne l’empêcha pas de puiser son énergie
dans les classiques, ce qui peut expliquer la diversité
de ses films, souvent entre démesure et tendresse, dixit
son dernier film avec Jean Pierre Mocky, « L’ibis
rouge », et l’on sait que Mocky ne fait pas dans
la dentelle… C’est au sein de la troupe des Pitoëff
qu’il fait ses débuts au théâtre,
puis il commence sa carrière cinématographique
par le muet, en 1925, dans « Feu Mathias Pascal »
de Marcel L’Herbier. Son succès est total tant
à la scène qu’à l’écran.
Il ne refuse ni l’opérette, ni le vaudeville et
encore moins le drame. Personne ne peut oublier son rôle
de Clo-Clo dans « Jean de la Lune » de Marcel Achard
en 1931. C’est un grand portraitiste, jusqu’à
la caricature, portant à la comédie humaine un
vif intérêt, comme l’avait si bien fait Molière,
et quand le succès d’une œuvre à laquelle
il tenait n’est pas au rendez-vous, la déception
est grande.
Mes films préférés se situent dans la période
de 1930 à 1960. Pitoyable caissier dans « La chienne
» en 1931 et clochard ébouriffé dans «
Boudu sauvé des eaux » en 1932, deux films de Renoir,
il incarne de façon magistrale le père Jules,
marinier tatoué, dans « L’Atalante »
de Jean Vigo en 1934. Son rôle le plus épique reste
celui de Molyneux alias Félix Chapel dans « Drôle
de drame » de Marcel Carné en 1937. Puis en 1939
viendront « Quai des Brumes » de Marcel Carné
et « Fric-Frac » de Claude Autan-Lara, où
il sera truculent en Jo les bras coupés. En 1950, on
le retrouve dans la peau de Méphistophélès,
personnage inquiétant de « La Beauté du
Diable » de René Clair et on ne peut passer sous
silence sa prestation de braconnier dans « La Poison »
de Sacha Guitry en 1951, pas plus que le vieux grognard d’«
Austerlitz » d’Abel Gance en 1959, une belle description
de la vie de ces pauvres gens qui avaient cru dans l’aigle
impérial.
Les vanités du monde le dégoutaient, ce n’est
pas le fruit du hasard s’il était qualifié
de misanthrope à cause d’attitudes boudeuses et
d’éclats de colère. Mais son sens de l’humour
le sauvait, un passeport en toute situation. Anarchiste débonnaire
à la Brassens, sa conscience relative des codes moraux
le conduisait plus près des marginaux que des honnêtes
gens ; il préférait le discours des clochards
aux littérateurs distingués avec lesquels il s’ennuyait.
Intelligence du cœur, esprit vif, vaste culture, il pouvait
se permettre de rejeter les critères de la culture académique…
ce qui explique, sans doute, que ses personnages les plus attachants
soient ceux de l’Atalante ou de Boudu.
Michel Simon a tourné dans plus de cent films ; certains,
moins connus, méritent cependant un détour : «
Feu Mathias Pascal » de l’Herbier en 1926, «
la Passion de Jeanne d’Arc » de Dreyer et «
Tire au flan » de Renoir en 1928, « Jean de la Lune
» de Jean Choux en 1931, « Le bonheur » de
Marcel l’Herbier en 1934, « Le dernier Tournant
» de Pierre Chenal en 1939, « La comédie
du Bonheur » de Marcel l’Herbier en 1942, «
Panique » de Duvivier en 1946, et la très caustique
« Vie d’un honnête homme » de Guitry
en 1953. Viennent ensuite « L’impossible monsieur
Pipelet » de Hunebelle en 1955, « Le Diable et les
dix commandements » de Duvivier en 1962, et ce superbe
grand-père dans « Le Vieil homme et l’enfant
» de Claude Berry en 1966. Son nom figure également
au générique d’un film inachevé «
Pivoine » d’André Sauvage de 1929. Son goût
de l’éclectisme lui fera accepter le rôle
d’un… érotologue dans le film de Jérôme
Savary : « Le boucher, la star et l’orpheline »
en 1975.
Pour résumer, je dirai que Michel Simon, comme le Jo
de Fric-Frac, était le rayon de soleil du cinéma
français. Un marginal tourné vers les défavorisés,
un empêcheur de tourner en rond. Dès qu’un
metteur en scène disait : « Action », Michel
Simon nous plongeait dans le rêve et le merveilleux. Il
est mort à Bry-sur-Marne en 1975.
Adieu, mon prince... |
| |
|
 |
|
 |
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |



|
|
Le
cercle des poètes disparus 1988-1989 |
|



|
|
J’ai
eu un prof de philo, devenue une amie très chère
pendant de longues années, qui aurait adoré ce
film, elle qui prenait le contre-pied de tout ce qui paraissait
suspect, ce qui pouvait être une insulte à l’intelligence.
La pauvre aurait été bien malheureuse si elle
avait dû enseigner dans la respectable académie
Welton, un endroit où les feuilles ne doivent tomber
qu’à l’automne. Ah ! les principes d’éducation
british qui ont fait les grandes heures du colonialisme... On
connait la suite. Pour ne pas risquer de me fâcher avec
la terre entière, je la passerai sous silence.
L’action se situe entre l’ère McCarthy et
la révolte des étudiants, on ne peut pas dire
que ce soit la meilleure époque… En 1959, les élèves
portent haut les couleurs des blasons de l’académie
Welton que l’on pourrait résumer ainsi : tradition,
discipline, honneur (ne pas trop insister sur ce sujet trop
sensible), excellence. Parfait ! si cela n’aboutissait
souvent aux excès contraires. Souvenons-nous de Paracelse
qui disait : « Tout est bon, rien n’est bon, seule
la mesure compte. » Mais sous la forme d’un professeur
d’anglais M. Keating (Robin William), un gros lutin va
mettre la pagaille. Sa devise: « La vie est courte, ne
perdons pas de temps » (carpe diem), c’est ainsi
que le cours d’anglais prend ses marques. Un vent nouveau
souffle et l’académie s’enrhume. Enseigner
à ses élèves que la poésie est vivante,
c’est donner un bâton pour recevoir des coups. Et
y prendre du plaisir, c’est franchement masochiste. Du
haut de l’Olympe, tombent, tour à tour, des poètes
comme Walt Whitman, Henry David Thoreau et même le dépoussiéré
William Shakespeare. Pauvre professeur qui montre à ses
élèves que la poésie n’est pas coupée
de la vie. Que de désordre ! Penser par soi-même,
quel crime odieux ! La situation va se gâter quand Neil
(Robert Sean Leonard) et Todd (Ethan Hawke) s’enflamment
pour ce nouveau professeur. Et le pire arrive lorsqu’ils
veulent recréer le cercle des poètes disparus
dont Keating fut jadis le fondateur. Le bon professeur n’avait
pas prévu qu’il allait aggraver les conflits père-fils.
La tragédie est en place... En 1959 à l’académie
Welton, que de sueurs froides !
Si le film distance « Breakfast Club » de 1984 dans
un thème similaire, c’est parce qu’il dégage
de grandes émotions, il n’a pas pris une ride,
il est intemporel. Peter Weir nous grise de poésie. Le
personnage de Robin Williams est attachant parce qu’il
est généreux, il connait bien la vie tout en errant
dans l’onirisme... C’est un hommage rendu à
l’indépendance de l’esprit et à la
liberté des mots. Il élève l’esprit,
fait réfléchir, dérange comme la liberté,
et le prix que l’on est prêt à mettre pour
l’obtenir. Rien à voir avec mai 68, n’en
déplaise aux nostalgiques. On peut en penser ce que l’on
veut, il reste une chose bien établie : le pire, c’est
l’indifférence, car depuis l’aube de l’humanité,
haïr ou aimer fait bouger les choses.
Je terminerai sur cette phrase du Gaspard de Verlaine : «
Suis-je né trop tôt ou trop tard ? Qu'est-ce que
je fais en ce monde ?... » Comme d’habitude, je
vous souhaite une bonne nuit…
|
| |
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
J’ai toujours pensé que le meilleur du cinéma
français se situait dans les années 30, pour une
raison fort simple, la quantité impressionnante de grands
comédiens tels Jouvet ou Simon. Mais, tombés dans
les oubliettes, il y eut aussi de merveilleux seconds rôles
féminins (j’ai évoqué les seconds
rôles masculins dans la 20e séance) qu’il
fallait remettre sur le devant de la scène, comme un
devoir de mémoire... |
|
| |

|
|
Je commencerais par l’une des plus anciennes, Sylvie,
pseudonyme de Louise Mainguené, née à Paris
en 1883. elle ne fut jamais une vedette, mais elle marqua le
cinéma de son époque par de belles compositions.
Durant les premières décennies du XXe siècle,
elle préfère le théâtre au cinéma,
mais on la voit dans des films muets dont « Britannicus
» de Camille de Morlhon en 1913. On la retrouvera plus
tard, en 1943, dans « Le Corbeau » de Clouzot
et dans « Les anges du péché » de
Bresson puis en 1944 dans « Le père Goriot
» de Robert Vernay. Duvivier la fit tourner dans quatre
longs métrages : « Carnet de bal » en
1937, « La fin du jour » en 1939, « Sous le
ciel de Paris » 1950 et « Le petit monde de Don
Camillo » 1951. Ses plus belles compositions restent «
Marie-Martine » d’Albert Valentin en 1943,
« Dieu a besoin des hommes » de Jean Delannoy en
1950 et « La vieille dame indigne » de René
Allio en 1965. Elle mourra en 1970.
|
|

|
|
| |

|
|
Souvent, lorsque je parle de cinéma avec quelqu’un,
cette phrase revient : « Oui, oui... maintenant que vous
le dites, je me souviens » Il en va ainsi de Marcelle
Geniat que l’on vit souvent dans des rôles de femme
acariâtre ou de mémé que l’on ne voudrait
pas avoir chez soi, genre Tatie Danièle. Le plus ancien
souvenir que je conserve d’elle, c’est dans le rôle
de la chouette des « Mystères de Paris »
de Gandera en 1935. En 1942, elle incarnera une femme particulièrement
torturée moralement dans « Le voile bleu »
de Stelli, un film avec Gaby Morlay, c’est d’ailleurs
ce film qui lui vaudra le qualificatif de « geignarde
» ! Pendant deux décennies, de 30 à 50,
elle excellera dans des rôles ingrats. Pour exemple, «
La Belle équipe » de Duvivier en 1936, et «
Le Loup des Malveneur » de Radot en 1942. Rien ne procède
du hasard, puisque, outre son métier de comédienne,
elle fut directrice d’une maison de redressement pour
jeunes filles à Boulogne Billancourt. Elle mourut en
1959.
|
|
 |
|
| |
 |
|
Ma préférée, c’est Jeanne Fusier
Gir et l’on peut dire que, dès 1930, le parlant
lui offre une place de choix. Sa voix fluette et son débit
haché produiront de larges effets comiques très
appréciés du public, c’est peut-être
cela qui la cantonna aux rôles de pipelettes revêches
ou de commerçantes volubiles. Elle excellera dans les
personnages pittoresques comme dans « Crainquebille »
de Jacques de Baroncelli en 1933, « Marie-Martine »
de Valentin et « Le Corbeau » de Clouzot en 1943,
« Falbalas » de Becker en 1945 et « Marie-Octobre
» de Duvivier en 1958. Dans les années 40, on commence
à la remarquer grâce à Guitry qui sait exploiter
ses qualités. Avec lui, elle fera « Remontons les
Champs-Élysées » en 1938, « Le destin
fabuleux de Désiré Clary » en 1941, «
La Malibran » en 1943, « Napoléon »
en 1955. Née en 1885, elle mourut en 1973.
|
|
 |
|
| |
 |
|
La plus classique, si l’on peut s’exprimer ainsi,
c’est Gabrielle Dorziat, puisqu’elle fut sociétaire
de la Comédie Française et qu’elle ne viendra
que très tard au cinéma ; c’est sans doute
l’explication de son parfait phrasé. Elle voit
le jour à Épernay en 1880. Sa personnalité
lui permet d’incarner des rôles à forte personnalité,
elle sait tout faire, des nobles mères aux affreuses
mégères. On peut dire que son talent d’actrice
est révélé au public avec « La Fin
du Jour » de Duvivier en 1939. Elle tourne avec les plus
grands : « Mollenard » de Robert Siodmak en 1937,
« De Mayerling à Sarajevo » de Max Ophüls
en 1940, « Falbalas » de Jacques Becker en 1944,
« Manon » d'Henri-Georges Clouzot en 1948, «
Les Parents terribles » de Cocteau 1949, « Un acte
d'amour » d’Anatole Litvak en 1954, etc. Dans «
Églantine » de Jean-Claude Brialy en 1972, elle
tient le rôle d’une dame âgée de 92
ans, elle en a 90 ! Elle mourut sept ans après en 1979,
elle avait 99 ans.
|
|
 |
|
| |
 |
|
J’ai un petit faible pour Fréhel, pseudonyme de
Marguerite Boulc’h, née en 1891, et son regard
désespéré. Je la revois dans le rôle
de Tania, la matrone de la casbah, dans « Pépé
le Moko » de Duvivier en 1936 ; pendant qu’elle
écoute l’un de ses disques, on aperçoit
au mur la photo d’une fille mince coiffée à
la mode 1900. C’est elle alors qu’elle s’appelait
alors Pervenche, un nom qu’elle abandonnera en 1909. Elle
apparaitra dans 16 films, de 1930 à 1950 et bien que
jamais elle n’occupe au cinéma la place qu’elle
occupa au cabaret, elle fut toujours très remarquée.
Ses plus beaux rôles resteront sûrement «
Cœur de lilas » d’Anatole Litvak en 1932 et
« Un Homme marche dans la ville » de Marcello Pagliero
en 1949. Elle finit dans la misère, dans tous les sens
du terme. Son regard reflétait cette mort qui la surprendra
en 1951, seule, dans un hôtel sordide de Pigalle.
|
|
 |
|
| |
 |
|
Je terminerais par une note plus gaie, Valentine Tessier, une
grande comédienne de théâtre. Enfant, elle
ne rêve que des planches et on la met en apprentissage
! Elle rate le conservatoire, qu’à cela ne tienne,
elle joue en province avant de rejoindre Jacques Copeau au Vieux
Colombier avec qui elle part en tournée à l’étranger.
Après la Première Guerre mondiale, c’est
le triomphe au théâtre et elle joue avec Louis
Jouvet. Le cinéma ne l’intéresse pas beaucoup,
cependant, elle apparaitra dans une vingtaine de films entre
1911 et 1959. Naturellement distinguée, elle n’eut
aucun mal à incarner des femmes du monde. On la remarquera
dans « Madame Bovary » de Renoir en 1934, «
La Charrette Fantôme » de Duvivier en 1939 et «
Maigret et l’affaire Saint-Fiacre » de Jean Delannoy
en 1958. Brialy la fait tourner une dernière fois au
cinéma dans « Églantine » en 1971,
elle avait presque 80 ans, elle était née 1892.
Elle s’éteindra à presque 90 ans en 1981.
|
|
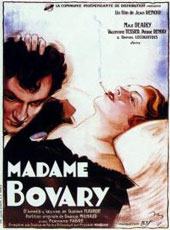 |
|
| |
Les cimetières sont remplis de merveilleux talents…
Pas étonnant que certains se laissent enfermer au Père-Lachaise
! |
|
| |

|
|
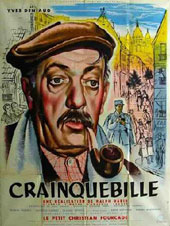 |
 |
 |
|

|
|
| |
 |
|
| |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
Spencer
Tracy 1900-1967 |
|
|
|
| |




|
|
Pour
moi, Spencer Tracy restera l’un des plus grands acteurs
américains. Je l’ai découvert grâce
à deux films qu’il tourna plutôt en fin de
carrière puisque (né en 1900 à Milwaukee
dans le Wisconsin, il mourut en Californie en 1967), il s’agit
de « Un homme est passé » de John Sturges
de 1955 et de « La Lance brisée » d'Edward
Dmytryk de 1954. Je les revois encore avec autant de plaisir
que dans les années 60.
Rien ne prédestinait Spencer Tracy, élève
chez les Jésuites et voué à la prêtrise,
à une carrière de comédien. Il ne montera
sur les planches qu’à la fin de ses études
et, en 1930, ce sera le triomphe avec la pièce «
The last mile » et le début d’une carrière
hollywoodienne. À la fin de l’année, il
sera la vedette de « Up the river » au côté
d’un autre débutant, Humphrey Bogart, et la Fox
le prendra sous contrat. Sa popularité sera à
l’égale de celle de James Cagney. En 1936, il quitte
la Fox pour la M.G.M. et c’est la consécration,
le cinéma va lui offrir des rôles à sa mesure,
et il devient une star à part entière. En 1941,
alors qu’il s’est marié depuis une vingtaine
d’années, il fait la connaissance de Katharine
Hepburn sur le tournage de « La femme de l’année
» et ce sera une longue histoire d’amour qui durera
jusqu’à sa mort sans que jamais il ne divorce.
Il recevra deux oscars, le premier pour « Capitaines courageux
» de Victor Fleming en 1937 et le second pour «
Des Hommes sont nés » de Norman Taurog en 1938.
Laurence Olivier déclara que c’est en le regardant
qu’il avait le plus appris sur son métier. Beau
compliment ! On peut même dire que sa présence
a empêché que ses films les moins bons tombent
dans le médiocre.
Ses premiers rôles furent très variés, car
on le retrouve en gangster cynique dans « Quick Millions
» en 1931, en prolétaire dans « Me and My
» en 1932, en prisonnier muré dans son secret dans
« Vingt mille ans sous les verrous » et en clochard
dans « Ceux de la Zone » en 1933, film dans lequel
il partage la vedette avec Loretta Young. Plus connue, sans
doute, est sa prestation de marin portugais dans « Capitaines
courageux » en 1937. Il deviendra un spécialiste
des personnages de caractère, authentiques. Il savait
être odieux ou sympathique avec autant de conviction.
Il excelle dans « Le père de la mariée »
en 1950 et sa suite « Allons donc, Papa » en 1951,
de Minnelli. Il mit son talent au service de grands cinéastes
tels que Frank Borzage (« La grande ville » en 1937),
Henri King (« Stanley and Livingstone » en 1939),
King Vidor (« Le grand passage » en 1940), et George
Cukor dans 5 rôles remarquables dont le plus méconnu
est celui de « The Actress » en 1953. Après
Vincente Minnelli, viendra John Ford, en 1958, avec l’incarnation
d’un politicien au seuil de la mort dans « Dernière
Fanfare ». Ensuite, dans les années 60, Stanley
Kramer lui proposera deux rôles qui ne seront pas à
la mesure de son talent : « Procès de
singe » en 1960 et « Jugement à Nuremberg
» en 1961. Il tourna avec les plus grandes actrices :
Joan Crawford, Lana Turner, Deborah Kerr ou Marlène Dietrich,
mais pour lui, aucune ne pouvait rivaliser avec Katharine Hepburn
avec qui il travailla neuf fois. C’est Cukor qui porta
leur couple au zénith dans « Madame porte la culotte
» en 1949, elle en avocate et lui en procureur, avec quelques
moments savoureux du couple au cinéma ; et aussi en 1952
avec « Mademoiselle gagne tout » qui mérite
d’être redécouvert, lui en manager sportif
un peu mou et elle en athlète énergique ; également
dans « La flamme sacrée » en 1942, moins
connu, où elle incarnait une veuve et lui un journaliste
qui tente de reconstituer la personnalité du défunt.
Le crabe planait et Spencer Tracy s’éteindra d’un
cancer en 1967. Il serait stupide d’oublier « Devine
qui vient dîner ? », mais mon film préféré
reste « Un homme est passé » et cette
image mémorable d’un homme imperturbable immobilisant
d’un seul bras un Robert Ryan, obscur tyran tenant une
petite ville d’ignorance et d’infamie sous son emprise.
Massif et solide à l’écran, les traits peu
marqués, des cheveux vite blanchis, c’était
Monsieur Spencer Tracy, avec un grand M ! |
|



|
|
| |
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
suite…
|
|
|
|
|